Dossier: Données pour la médecine
Comment la médecine personnalisée pourrait sauver encore plus de vies
L’influence des différences génétiques sur le traitement peut désormais être utilisée avec succès chez certaines personnes atteintes d’un cancer. Mais de telles thérapies personnalisées pourraient aller encore plus loin à l’avenir.
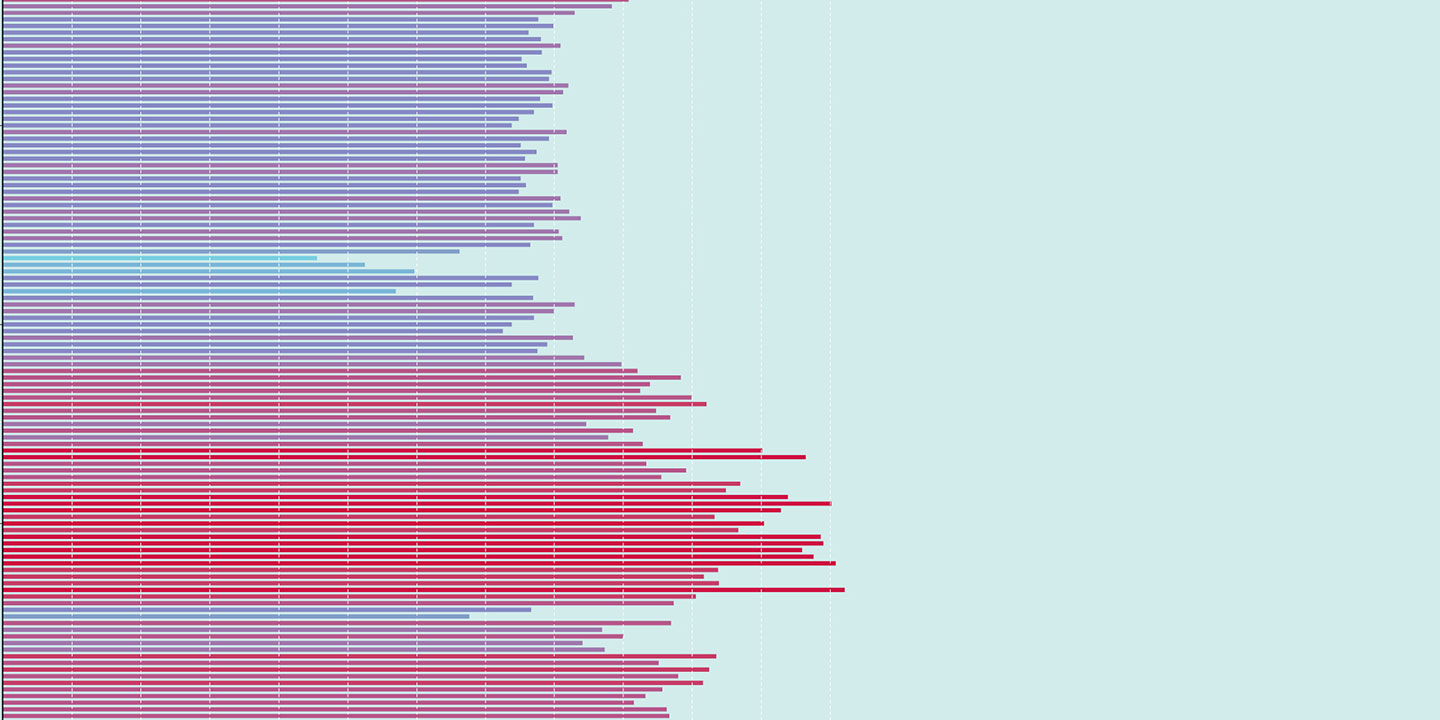
Le spécialiste en données Granville Metheson a partagé ses données très personnelles avec tout le monde. On peut y voir son rythme cardiaque pendant la soutenance de sa thèse, qui varie entre 40 et 120 battements par minute. | Graphique: Granville Matheson; Adaptation: Oculus Illustration
A son arrivée aux urgences de l’Hôpital universitaire de Zurich, Michael Keller ne peut pratiquement plus respirer, car du liquide s’est accumulé autour de ses poumons. Après une ponction pour soulager la pression, l’analyse du liquide montre qu’il contient des cellules cancéreuses malignes. Les images livrées ensuite par une tomographie assistée par ordinateur laissent apparaître des ombres sur les poumons, probablement des métastases. A cet instant, Michael Keller – son nom est fictif, mais sa personne et sa maladie sont réelles – et ses médecins savent deux choses: d’une part, que le patient souffre d’un cancer, de l’autre, que la situation est sérieuse, la maladie ayant déjà essaimé. Il y a encore vingt ans, ce diagnostic était une condamnation à mort.
Pourtant, les médecins pouvaient alors déjà caractériser les tumeurs au microscope. «Ils obtenaient ainsi des informations sur l’organe d’origine, le type de tumeur et son agressivité, et de premières indications pour les traiter», explique Andreas Wicki, oncologue en chef à l’Hôpital universitaire de Zurich. En présence de métastases, cette approche n’avait toutefois que très peu de chances de succès: en l’an 2000, tous types de cancers confondus, à peine 5% des patientes et patients à un stade avancé survivaient. Aujourd’hui, 20% des personnes atteintes de métastases s’en sortent grâce aux thérapies personnalisées.
Les premiers génomes humains étaient porteurs d’espoir
Désormais, ce sont en effet souvent les gènes qui révèlent l’origine d’une tumeur et la meilleure manière de la traiter. «La plupart du temps, le cancer se développe en raison de l’altération du patrimoine génétique au cours de la vie», explique Andreas Wicki. Grâce aux méthodes modernes de séquençage de l’ADN, les spécialistes dans les hôpitaux suisses sont aujourd’hui en mesure de rendre ces mutations visibles. A cette fin, ils analysent le génome des cellules tumorales. Selon le type de cancer, on examine 50 à 400 gènes dont on sait qu’ils peuvent contenir des mutations favorisant le développement de la maladie.
Pour un cancer de la peau, du sein ou du poumon, ces analyses génétiques font désormais partie du diagnostic standard. Dans le cas du cancer du poumon par exemple, elles permettent d’identifier une dizaine de sous-groupes de tumeurs et de les traiter spécifiquement. Ainsi, pour les personnes chez qui la croissance de la tumeur est stimulée par la mutation d’une protéine appelée facteur de croissance épidermique ou EGF (de l’anglais «epidermal growth factor receptor»), les médecins utilisent un médicament qui inhibe justement la production de cette protéine. Les malades qui présentent une mutation de la tyrosine kinase RET reçoivent, quant à eux, un inhibiteur du RET. Et lorsque les tumeurs ne présentent aucune des mutations traitables, les oncologues misent sur l’immunothérapie ou une combinaison d’immunothérapie et de chimiothérapie. De tels traitements ciblés sont aujourd’hui possibles grâce aux scientifiques qui, au début des années 2000, après le décryptage du génome humain, se sont mis à étudier l’influence des différences génétiques pour développer des principes actifs ciblés.
Une semaine après son hospitalisation, Michael Keller a, lui aussi, reçu les résultats de son analyse génétique. Il s’est avéré qu’il souffrait d’un cancer de la peau et que cette forme de la maladie se traitait le mieux par immunothérapie. Depuis, les médecins lui administrent toutes les trois semaines une perfusion contenant un inhibiteur de point de contrôle. Le but est de pousser le système immunitaire à combattre les cellules cancéreuses en inhibant les protéines qui le régulent.
De nombreuses maladies résistent encore
La grande majorité des maladies et leurs traitements varient d’une personne à l’autre: nous ne souffrons pas tous des mêmes effets secondaires des médicaments, ne courons pas le même risque de maladies cardiovasculaires – et de nombreux autres maux – et ne présentons pas les mêmes symptômes en cas d’infection. La médecine personnalisée veut exploiter ces caractéristiques individuelles pour améliorer le traitement de chaque individu. Mais ces thérapies sur mesure n’ont encore atteint les patients que pour certains types de cancers et de maladies rares, telle la mucoviscidose. Elles renferment pourtant un potentiel immense pour aider encore de nombreuses autres personnes.
Le Covid-19 en est l’exemple le plus récent. «Les évolutions graves ne pouvaient de loin pas toutes être expliquées par l’âge ou des pathologies antérieures», note Jacques Fellay, directeur de l’unité de médecine de précision à l’Hôpital universitaire de Lausanne (CHUV). Avec une équipe internationale, il a étudié pourquoi un grand nombre de personnes jeunes et en bonne santé ont dû être placées sous respirateur ou sont même décédées après une infection par le coronavirus. A cette fin, les scientifiques ont analysé les anticorps et l’information génétique de quelque 1500 patientes et patients de services de soins intensifs sur cinq continents. Ils ont ainsi découvert certaines mutations qui désactivent des protéines de la réponse immunitaire et rendent les malades vulnérables à l’infection. «Cela nous permet d’expliquer près de 20% des cas graves atypiques», note Jacques Fellay. Son équipe étudie aussi pourquoi, chez une petite partie des personnes séropositives, cette autre infection est restée sous contrôle même sans médicaments, ou pourquoi tout le monde ne réagit pas de la même manière au virus de l’hépatite B.
Afin que de telles connaissances, issues de la recherche fondamentale, puissent à l’avenir servir aux traitements, les scientifiques devront non seulement identifier les variations biologiques et génétiques, mais aussi comprendre leur influence sur une maladie. «Pour faire des progrès dans ce domaine, nous avons surtout besoin de plus de données exploitables que jusqu’à présent», explique Jacques Fellay. Mais selon lui, il existe des obstacles en la matière en Suisse. C’est aussi l’avis de Christiane Pauli-Magnus, codirectrice du département de recherche clinique à l’Université de Bâle. Consultante en rhumatologie, elle se heurte au quotidien aux limites de la médecine actuelle. Dans sa spécialité, il n’existe que peu de traitements. Et tous sont efficaces chez certaines personnes et pas chez d’autres. «Nous ignorons pourquoi», déplore la scientifique. Ne reste donc qu’ à essayer une thérapie après l’autre. «Si nous comprenions plus tôt pourquoi c’est ainsi, nous pourrions aider les malades plus rapidement sans les accabler de traitements inutiles.»
Pour Christiane Pauli-Magnus et Jacques Fellay, les écueils évoqués se situent au niveau de la collecte et de l’utilisation des données qui proviennent essentiellement de deux sources: des études cliniques et de la routine hospitalière, lors du traitement des personnes admises. Ces données contiennent par exemple les valeurs vitales, les résultats des analyses de laboratoire, les clichés d’imagerie médicale, en bref: toute l’histoire médicale de ces personnes. Ces informations sont stockées localement et de manière protégée dans les hôpitaux. «Il s’agit de données précieuses, que nous devrions absolument utiliser», note Christiane Pauli-Magnus. Lorsqu’on demande aux personnes hospitalisées si elles souhaitent que leurs données médicales puissent être exploitées à des fins scientifiques, huit sur dix y consentent. Le problème est qu’on ne leur pose pratiquement jamais la question.
Des dispositions légales moyenâgeuses
Cela s’explique en grande partie par le fait que les patientes doivent encore signer leur consentement sur le papier, commente Christiane Pauli-Magnus, ce qui complique la procédure, surtout une fois qu’elles ont quitté l’hôpital. «Lorsqu’on envoie les formulaires par La Poste à leur domicile, ils finissent souvent au vieux papier», relève la scientifique. «Dans notre monde numérique, où nous envoyons sans crainte des photos et des données privées non cryptées à l’autre bout du monde, cette obligation légale de signature manuscrite semble tout droit sortie du Moyen Age.» Elle appelle ainsi de ses vœux le passage à l’econsent – le consentement électronique des personnes traitées.
Le deuxième obstacle réside dans le manque d’hétérogénéité des données de routine, qui passe par des détails apparemment anodins, comme l’indication du sexe de la personne traitée. Les codes tels homme/femme, h/f, male/female peuvent être déclinés à l’infini. Dès lors, il est pratiquement impossible de comparer les données issues de différents hôpitaux.
Le Swiss Personalized Health Network (SPHN) s’attelle depuis cinq ans à trouver des solutions à ce problème. Cette initiative, financée par la Confédération, a mis en place un réseau regroupant des hôpitaux universitaires, des hautes écoles, le FNS, la Swiss Clinical Trial Organisation et d’autres acteurs du système de santé suisse. «Il s’agit de réunir toutes les parties concernées autour d’une table, afin de mettre en place une infrastructure de recherche sûre pour l’échange de données et de pouvoir développer des normes pour leur traitement», explique Urs Frey, président du SPHN National Steering Board. Actuellement, cette harmonisation s’effectue par étapes, au travers de projets soutenus. Des entrepôts de données ont été mis en place dans les hôpitaux universitaires pour l’enregistrement normalisé, éthique et juridiquement conforme des données des personnes hospitalisées. Ces entrepôts sont reliés entre eux ainsi qu’aux universités et l’ETH Zurich par une nouvelle plateforme de réseaux sûre appelée BioMedIT.
Les initiatives arrivent à leur terme L’initiative SPHN doit toutefois s’achever en 2024. Et l’on ignore encore comment l’infrastructure de données sera poursuivie et financée à l’avenir. Une autre lacune devrait en outre apparaître prochainement avec la fin du financement des études longitudinales. Jusqu’en 2020, le FNS en a financé une dizaine, qui suivaient par exemple pendant des décennies des malades atteints de pathologies pulmonaires ou cardiaques. «De telles données sont extrêmement précieuses, car elles ne sont pas qu’un instantané et montrent comment la santé des personnes qui participent à l’étude évolue», indique Christoph Meier, chef Projets Sciences de la vie au FNS. Les dernières études se termineront toutefois aussi en 2024. La forme que pourrait prendre un éventuel nouveau financement n’est pas encore clairement définie.
En attendant, la communauté scientifique souhaite un engagement plus important de la part de la politique de la santé. «Pour faire progresser rapidement la médecine personnalisée, le système de santé suisse devrait se concentrer davantage sur la recherche», déclare Jacques Fellay. Selon l’oncologue Andreas Wicki, cela nécessiterait un autre système d’incitation. «Nous aurions besoin d’un financement qui récompense les fournisseurs de prestations de santé qui génèrent des données de recherche de bonne qualité et échangeables.»
Michael Keller a en tout cas de bien meilleures chances de survie grâce aux thérapies personnalisées. Avant leur apparition, moins de 10% des personnes souffrant d’un mélanome avec métastases étaient encore en vie dix ans après le diagnostic. Aujourd’hui, c’est le cas pour plus de la moitié d’entre elles.




