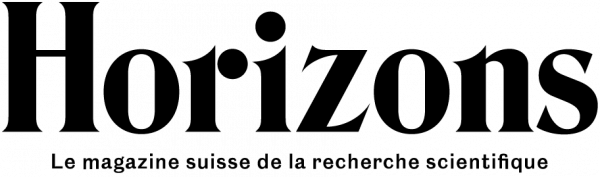PORTRAIT
La jeune femme et la mer
Margot Camus-Romelli a obtenu son baccalauréat à 15 ans, a fugué à 16 ans et organisé deux ans plus tard une expédition scientifique dans l’Atlantique Nord. Elle déborde d’idées, mais aussi de questions sur le sens de la vie.

A terre, Margot Camus-Romelli s'était battue corps et âme pour son projet en mer, mais elle s'est ensuite aperçue que les tâches de recherche à bord l'épanouissaient moins que prévu. | Photo : Sébastien Agnetti / 13Photo
«Ma phobie, c’est d’être derrière un bureau. Et c’est compliqué d’éviter ça quand on est ingénieure. Enfin, pour faire simple.» Compliqué contre simple: un premier contraste qui en annonce tant d’autres. En une heure et demie d’entretien, Margot Camus-Romelli virevolte entre biologie marine et mélancolie, désert et apnée, littérature et expérience de mort imminente. A 22 ans, l’étudiante en master à l’EPFL a dans la tête autant de projets que de questionnements. Une fonceuse qui ralentit une fois sur les flots, une performeuse pleine de doutes à la personnalité tourbillonnante.
A la fin du covid, à 19 ans, elle lance à l’EPFL une association estudiantine pour monter des expéditions scientifiques maritimes et lacustres. Elle est alors en deuxième année de bachelor. Sailowtech veut contribuer à préserver les océans en récoltant des données scientifiques sur les planctons et leur environnement. Il s’agit aussi de démocratiser la science et d’amener ses collègues à faire l’expérience des écosystèmes aquatiques. La jeune femme gère un budget de 180 000 francs, trouve des sponsors et tisse des collaborations avec des instituts de recherche océaniques.
Le «low-tech» caché dans le nom de l’association l’indique: il s’agit aussi de créer une science plus frugale. Etudiants et chercheuses fabriquent trois des instruments embarqués, dont une caméra d’observation sous-marine et un capteur mesurant la température de l’eau, sa conductivité électrique et sa profondeur. «J’ai voulu montrer qu’on peut faire de la recherche de bonne qualité de manière économique, tout en réduisant son impact environnemental, explique Margot Camus-Romelli. La science est encore trop souvent élitiste, pécuniaire et peu respectueuse de l’environnement.»
Etudiante, navigatrice et écrivaine
Margot Camus-Romelli a entamé en 2019, à l’âge de 17 ans, ses études à l’EPFL, où elle poursuit un Master en sciences de la vie. Elle y a fondé et présidé l’association estudiantine Sailowtech, qui développe des instruments scientifiques avec des technologies simples et mène des campagnes scientifiques lacustres et marines. Elle a dirigé une expédition de quatorze mois dans l’Atlantique Nord et achève actuellement l’écriture de son pre-mier livre. Elle est née à Tunis et a grandi en Bretagne. Son grand-père était marin et son arrière-grand-père aviateur.
Le premier projet se nomme Atlantea: quatorze mois en mer, 25 000 km parcourus dans l’Atlantique Nord, et des centaines d’analyses et d’échantillons comprenant l’observation de plus de 300 espèces de planctons. L’équipage se compose d’un skipper, de six étudiantes et étudiants, dont deux changent tous les trois ou quatre mois. La vie à bord est rythmée par les prises d’échantillons d’eau quotidiennes et les analyses, les tâches courantes et la navigation. Les journées au port sont passées à transmettre les données, envoyer des échantillons pour des analyses génétiques et se coordonner avec les équipes de recherche partenaires. Margot Camus-Romelli est l’une des coordinatrices scientifiques, elle identifie les planctons au microscope, gère l’intendance, cuisine.
En mer, toutes les certitudes sont bouleversées
D’un côté, «la vie est facile sur un bateau», dit la jeune Française. «Car même si les conditions sont dures, sans confort et qu’on n’a pas d’espace, on doit se laisser aller. On n’a pas de téléphone, pas d’internet, on va d’un point A à un point B. Ce sont la météo et le rythme des jours et des nuits qui dictent notre itinéraire.» De l’autre, l’expérience déclenche chez elle une profonde remise en question: «J’avais porté le projet à bout de bras sur terre, mais une fois en mer, mes certitudes se sont effondrées.»
C’est l’effet qu’ont eu sur elle l’immensité de l’océan et le froid intense vécu au Groenland à la fin de la mission: «Je me suis rendu compte que les tâches de recherche à bord m’intéressaient moins que prévu, que j’avais de la peine à gérer le quotidien. Je me suis sentie vide, comme une imposteure qui aurait laissé tomber son équipe.» Elle passe beaucoup de temps à réfléchir, à s’immerger dans le paysage marin, à plonger avec bouteilles ou sans, en apnée.
Le retour à terre en août 2024 est rude: «Il m’a fallu plusieurs mois pour réaliser tout ce que l’expédition m’avait apporté. On revient de la mer totalement transformée, mais il semble que rien n’a changé sur terre. On se trouve en décalage total.» Pour digérer cette étape, elle rédige un livre sur son expérience, qu’elle s’apprête à envoyer aux maisons d’édition. Il mêle réflexions personnelles, souvenirs d’enfance, poésies et dessins à l’aquarelle. Elle a depuis quitté l’association et repris des études en master à l’EPFL, troquant la biologie marine contre la physiologie de la plongée – elle planifie un séjour aux Etats-Unis de huit mois pour étudier l’évolution de l’azote dans le corps humain à 100 mètres de profondeur.
Une première motivation est de contribuer à la démocratisation de la plongée, qui permet de récolter des données scientifiques précieuses pour la protection des milieux marins. Une autre est que «cette activité est un vecteur d’émerveillement qui peut conduire à l’éveil des consciences. Il faut connaître cette expérience sensible absolument magnifique: être sous l’eau, rencontrer les êtres vivants qui peuplent la mer, voir un corail qui blanchit, ou un requin pris dans des filets.» Elle insiste: «Sans l’océan, l’humain meurt.»
Recherche de sens après des expériences extrêmes
Née en Tunisie, Margot Camus-Romelli vit au Maroc jusqu’à l’âge de 6 ans, avant que sa famille ne s’installe en Bretagne. Elle retourne au Maghreb chaque année et, à 10 ans, elle fait l’expérience du désert: au sommet d’une dune, elle découvre un océan de sable s’étendant à l’infini. «Une chance inouïe», mais aussi «une expérience presque trop violente» qui lui imposera le besoin d’être constamment connectée à la nature. «A ce moment s’est ouvert quelque chose qui ne s’est jamais refermé. Toute ma vie, je me suis sentie comme une étrangère, à évoluer dans un monde que je ne comprends pas, trop brutal et trop déconnecté d’une temporalité plus douce» – un paradoxe pour celle qui court d’un projet à l’autre, et qui dit avoir énormément de difficultés à se poser.
Elle passe son bac par correspondance, à 15 ans. Elle fugue l’année suivante pour éviter les coups d’un père violent – il lui importe autant de ne pas cacher cet épisode de sa vie que de souligner l’importance de pardonner et d’avancer. Elle raconte encore une expérience de mort imminente, lorsqu’une investigation d’un problème cardiaque tourne mal à l’hôpital. Elle frôlera la mort une fois de plus lorsqu’elle pousse trop loin un entraînement d’apnée lors de l’expédition Atlantea.
Sa quête de sens semble loin d’être achevée. Actuellement, elle travaille comme monitrice de voile, a rejoint un club d’apnée, participe à un concours d’éloquence et se forme au coaching – pas pour coacher les autres, mais elle-même. Son master inclut également un mineur en management: «Nous avons besoin des contributions des gens qui font de la science pour la science, mais ce n’est pas pour moi. Je veux contribuer à une science sur le terrain et peut-être moins ethnocentrée. Cela veut dire se frotter à des enjeux politiques, sociaux, sanitaires et économiques. J’ai aussi un grand rêve: travailler pour le CICR.»
Elle dit avoir une grande reconnaissance envers l’EPFL – qui lui a accordé une bourse à l’âge de 17 ans – et se sentir bien en Suisse. «Les gens ici ne sont pas les pantouflards qu’on décrit parfois. Ils sont entreprenants et ouverts à l’aventure.» La Suisse pourrait donc devenir un lieu d’ancrage permanent pour elle.