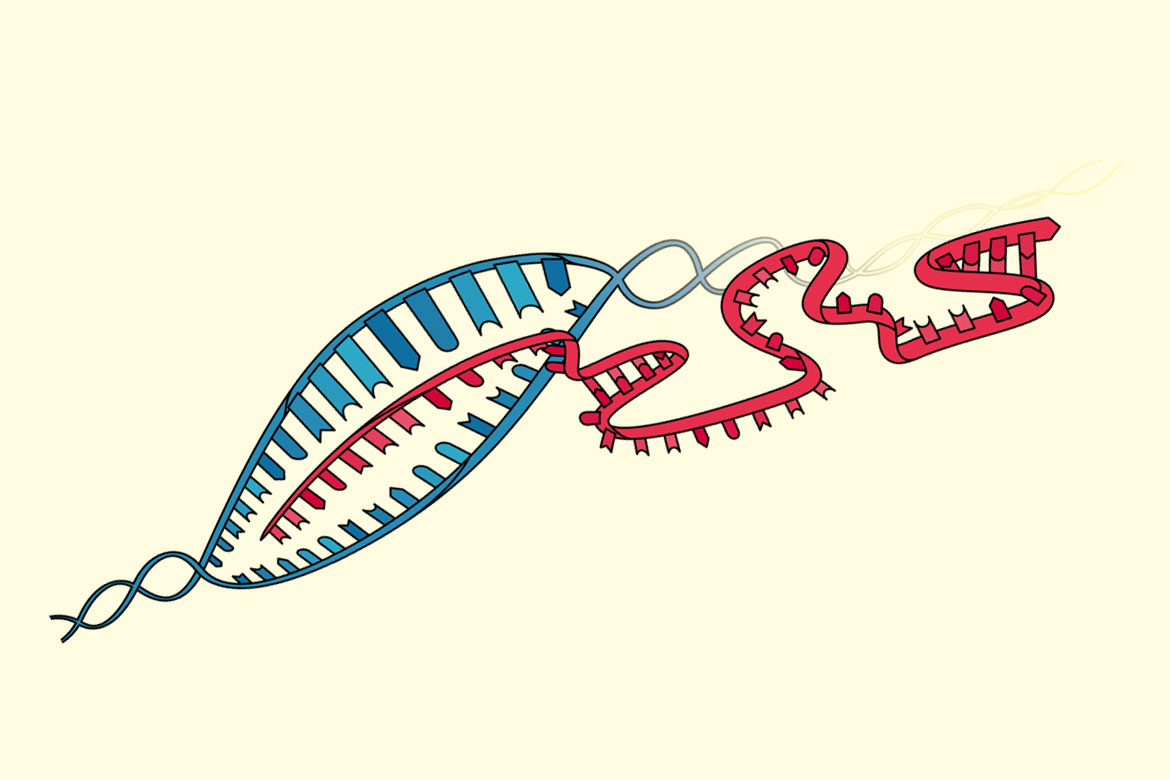Dossier: Cinéma, faits et fiction
«Produire des images iconiques, c’est la grande force du cinéma»
Crainte d’une guerre nucléaire, consternation devant des mineurs ayant des relations sexuelles – les films peuvent se graver dans la mémoire collective ou déclencher des débats houleux. Martin Bürgin, historien, explique ce que le cinéma induit dans nos esprits.

Le plaisir des scandales – Martin Bürgin analyse les films qui ont déclenché l'indignation. Et en tant que programmateur d'une série de films sur plusieurs années, il en discute également avec le grand public. | Photo: Fabian Hugo, prise au cinéma Rex de Berne
Martin Bürgin, pourquoi le film Netflix «Don’t look up» a-t-il fait tant de bruit?
Il reprend des thèmes très débattus dans les médias: une comète que certains ne veulent pas voir comme métaphore de la négation du réchauffement climatique, le populisme politique, les divers camps qui ne s’écoutent pas. Il réunit aussi une brochette de stars. Tout cela le rend passionnant pour les médias.
Aurait-il eu ce succès sans Meryl Streep, Leonardo Di Caprio et compagnie?
On peut effectivement se demander si nous parlerons encore de «Don’t look up» dans vingt ans. D’autres films ont probablement mieux traité la question du climat.
Revenons-en à «Don’t look up»: un film peut-il éduquer les gens?
(Il rit) La fonction éducative du cinéma: le rêve de tous les cinéastes activistes et départements de propagande. En fin de compte, il reste difficile de répondre à cette question. On peut en revanche constater que, depuis les années 1980, les films consacrés à la destruction de l’environnement par les êtres humains, au réchauffement climatique, à la déforestation ou encore à un monde post-guerre nucléaire se multiplient. Certes, dans ce cas, on vise souvent une fonction éducative. On joue sur les peurs dans l’espoir d’inciter le public à adopter un comportement plus durable à l’égard de la nature.
De quels films parlez-vous?
Pensons à «The Day after» ou à des blockbusters tels «Waterworld», «The Day after Tomorrow » et «Avatar», et aussi à de plus petites productions comme «Tank Girl» ou des films d’animation tels que «Nausicaä de la Vallée du Vent» et «Princesse Mononoké».
«Waterworld» de Kevin Costner?
Il manque un peu de profondeur. (Il rit) C’est un bon point. Mais les blockbusters d’action atteignent un large public. Et peut-être aussi un public qui n’a pas forcément d’affinités avec la politique environnementale. «Waterworld » commence par la fonte des calottes glaciaires et la Terre en grande partie inondée. Les gens vivent sur des îles bricolées et sont à la recherche de terrains fertiles. La représentation d’une Terre uniquement constituée d’eau s’imprègne dans les esprits.
Comment de petites productions nous marquent-elles?
«Tank Girl» date de la même époque. Un film sur une punk qui vit dans un tank et lutte contre les grandes entreprises. Contrairement à «Waterworld», le réchauffement climatique conduit ici à la transformation de la Terre en désert. Deux scénarios différents qui illustrent les conséquences du réchauffement climatique, tournés tous deux en 1995. «Tank Girl» traite en outre de capitalisme prédateur et de mondialisation. Un discours typique des années 1990: des gouvernements qui perdent de leur pouvoir et les grandes entreprises qui dominent le monde.
Ces films reflètent les craintes de la société. Peuvent-ils les renforcer?
Je n’en suis pas sûr. Mais en tant que média, le cinéma peut changer les débats en transformant des discussions techniques et politiques en histoires, en les mettant en scène dans des images, des sons et des dialogues accrocheurs. Ceux-ci sont ensuite repris par le grand public. Un film a surtout le pouvoir de produire des images iconiques.
Avez-vous un exemple d'images devenues iconique?
Les champignons atomiques au-dessus du paisible Kansas dans «The Day after», l’éclair après le déclenchement de la bombe atomique, le laminoir de feu, les retombées radioactives qui recouvrent tout… sont autant d’images puissantes gravées dans la mémoire du public et qui font désormais partie intégrante de la mémoire collective. C’est là, la grande force du cinéma. Nous pensons savoir à quoi ressemble une guerre nucléaire, même si nous n’en avons jamais vu.
Un exemple actuel de cette force?
La série «The Handmaid’s Tale», tournée sous l’ère de Donald Trump: une dystopie qui dessine une société patriarcale, totalitaire et chrétienne fondamentaliste, dans laquelle la fertilité est devenue rare. Les femmes en âge de procréer y sont considérées comme des esclaves sexuelles. Lors de manifestations contre Trump, des activistes se sont déguisées comme telles, notamment quand Brett Kavanaugh devait devenir juge à la Cour suprême – un évangéliste qui a été accusé de contrainte sexuelle. En protestant dans les vêtements emblématiques des handmaids, les militantes ont imagologiquement lié Kavanaugh au système de domination patriarcal et théocratique de la série.
Certains films récoltent de véritables tempêtes d’indignation. Tel «Kids» en 1995, avec des scènes de sexe entre mineurs. Un scénario de scandale typique?
A l’écran, le sexe entre mineurs recèle certes un potentiel de scandale. «Kids» s’est vu reprocher d’être un film voyeuriste aux accents pornographiques et pédophiles. Il est important de noter encore qu’il a été produit par Disney, une société de production qui s’efforce de donner une image favorable de la famille. Mais sa valeur sociopolitique réside dans la façon dont il a marqué le débat sur le VIH, en le mettant en scène sans compromis, dans le langage des jeunes, caméra à l’épaule et avec des actrices et acteurs non professionnels. Tout cela confère de l’authenticité, d’où précisément son succès. C’est aussi un film iconique.
Des films peuvent-ils briser des tabous?
Oui. Précisément en suscitant des discussions ou en les attisant. Finalement, des thèmes deviennent moins tabous quand on les aborde publiquement. Mais ce processus n’est pas linéaire. Des tabous que l’on croyait levés peuvent réapparaître. Et la conception de ce qui est tabou varie selon les groupes sociaux.
De tels groupes se sont affrontés en raison de «The Last Temptation of Christ» de 2009. Des cinémas ont même été attaqués.
Martin Scorsese montrait un Jésus plein de doutes, et de désirs et de rêves. Un Christ très humain, en somme. Dans une scène onirique, on le voit avoir des relations sexuelles avec Marie Madeleine. Pour bien des croyants et croyantes, c’était trop humain et cela a provoqué d’énormes protestations dans le monde. Des Etats ont fait censurer le film. Simultanément, des théologiens et des progressistes ont salué l’image donnée de Jésus. Il y avait deux questions fondamentales: comment Jésus est-il pensé et où est la limite du montrable?
La liste des films à scandale de Wikipédia nomme «Antichrist» de 2009 comme le plus récent. Est-ce que plus rien ne peut nous ébranler?
(Il rit) Si nous considérons la création cinématographique occidentale, les choses sont effectivement plutôt calmes pour le moment.
Et au-delà du monde occidental?
C’est différent. Cette année par exemple, la production Netflix «Perfect Strangers» a déclenché la fureur en Egypte. Un film en soi inoffensif. Un groupe d’amies et d’amis se réunit et décide de divulguer les messages reçus sur leurs portables pour un soir. Cela traite de sexe et d’homosexualité. Ce qui a provoqué l’indignation, allant du shitstorm sur les réseaux sociaux à des plaintes en justice, en passant par des attaques de députés contre Netflix.
Une nouvelle ère s’ouvre-t-elle?
Avec Netflix et d’autres plateformes de streaming, l’accès aux films change effectivement. Les possibilités de censure sont limitées, contrairement au cinéma ou à la télévision, contrôlés par l’Etat. Le public peut consommer ces films dans l’espace privé et sans contrôle social. Les services de streaming peuvent ainsi viser de nouveaux marchés – avec succès. En janvier, «Perfect Strangers» a été le film Netflix le plus regardé en Egypte. Cela montre aussi que les scandales génèrent du public. Mais surtout, on assiste à une mondialisation des processus de scandalisation. C’est passionnant.
Vous êtes responsable d’une série de films à scandale qui durera plusieurs années à Baden, en Argovie. Pourquoi?
Je trouve séduisante l’idée de transmettre la science dans un cadre culturel. Les scandales en tant que processus permettent de montrer de façon compréhensible comment différents groupes sociaux aux visions du monde différentes entrent en collision. Et cela, parfois de manière très émotionnelle, comme cela s’est produit avec «Kids» ou «The Last Temptation of Christ».
Vous montrez aussi des films racistes. Cela vous a valu des critiques.
C’est vrai. Mais nous débattons de ces films. «Jud Süss», par exemple, fut l’un des plus grands instruments de la propagande nazie et sa mise en scène était habile du point de vue dramaturgique. Un de mes amis historiens estimait qu’il ne fallait pas le montrer en public. Je ne suis pas d’accord. En déconstruisant de tels films, nous brisons leur prétendue aura. Il est plutôt dangereux de traiter le film comme s’il avait en soi le pouvoir de transformer les gens et de les rendre antisémites. J’estime au contraire que nous lui conférons cette aura que si nous renonçons à le soumettre à la critique. Je crois ici au pouvoir éclairant de la science.