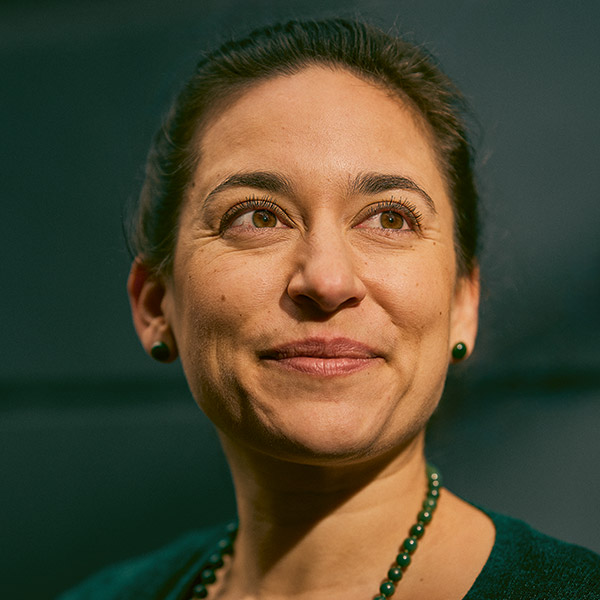ANTI-SCIENCE
«Les universités d’élite sont perçues comme ennemies des Etats-Unis»
La science est sous le feu des critiques aux Etats-Unis. Claudia Brühwiler, professeure à l’Université de Saint-Gall et experte en conservatisme, explique les raisons de la politique anti-scientifique de l’administration Trump.

Claudia Brühwiler estime que la diversité dans les hautes écoles est essentielle, et cela vaut également pour la diversité idéologique. | Photo: Ladina Bischof
Claudia Brühwiler, des agences fédérales sont démantelées, des fonds alloués à la recherche réduits et des institutions comme l’Université de Columbia attaquées. Dans votre podcast «Grüezi Amerika», vous avez réagi à l’hostilité à l’égard de la science aux Etats-Unis. Que s’y passe-t-il?
C’est presque comme un rêve fiévreux du mouvement conservateur.
Quel est donc le lien entre conservatisme et antiscience?
On observe différentes attitudes à l’égard du progrès scientifique et de son rôle sociétal aux Etats-Unis. Le libéralisme américain s’appuie sur une conception technocratique de la société. Le gouvernement idéal est guidé par l’expertise. Les conservateurs, par contre, se ferment à certaines découvertes scientifiques depuis le début du XXe siècle.
Commentatrice prisée
Claudia Franziska Brühwiler (43), professeure de pensée et culture politiques américaines à l’Université de Saint-Gall, a lancé le podcast Grüezi Amerika peu après les dernières élections présidentielles aux Etats-Unis. Elle a effectué divers séjours de recherche dans différentes universités américaines et enseigne la politique, l’histoire et la culture des Etats-Unis. Elle est très
prisée en tant que commentatrice des développements actuels.
Par exemple?
Cela a débuté avec le procès Scopes en 1925, lorsqu’un professeur de biologie a tenté de contester l’interdiction de la théorie de l’évolution dans les écoles du Tennesse. Il a perdu, mais l’affaire a entraîné un éveil politique de la tranche de population appelée «Bible Belt». Le mouvement conservateur, qui s’est renforcé après la Seconde Guerre mondiale, valorise davantage la tradition et la foi que la science. Cela se traduit par une opposition à l’enseignement de la théorie de l’évolution ou par la présence relativement importante d’écoles confessionnelles. Dans le conservatisme, les universités d’élite sont perçues comme des adversaires des Etats-Unis.
Quelle est l’erreur de ces institutions à leurs yeux?
Des conservateurs critiquent la composition des facultés, surtout en sciences sociales et humaines. Sur le plan idéologique, le milieu universitaire aux Etats-Unis ne serait pas diversifié. Il est vrai que, jusqu’à la fin des années 1990, des enquêtes montraient que moins de 50% du corps enseignant se considérait comme progressiste ou très progressiste. Dans un sondage actuel de l’Université Harvard, cette part dépasse les 75%, et moins de 3% se disent conservateurs. Cela entraîne une ségrégation des thèmes et des personnes. Dans mon domaine, la théorie politique, j’ai moins de chances de publier dans de prestigieuses revues si j’aborde des sujets conservateurs. Un de mes amis a été harcelé au sein de sa faculté parce qu’il était le dernier conservateur, très modéré, de l’établissement. Les gens aux opinions conservatrices se regroupent donc dans certaines universités telles que le Hillsdale College chrétien, l’Université évangélique Liberty et l’Université mormone Brigham Young.
C’était donc une erreur d’exclure les conservateurs?
La diversité importe à tous égards, y compris l’idéologie qui devrait aussi être représentée dans les universités. La tendance décrite n’est pas totalement nouvelle et existe aussi en Europe, mais la situation est plus explosive aux Etats-Unis et touche des institutions au statut plus élevé, considérées comme des tremplins vers le pouvoir, telles Harvard, Yale, Princeton et Columbia. Ces dernières années, deux facteurs ont contribué à l’hostilité envers les universités: la liberté d’expression et les politiques de diversité, d’égalité et d’inclusion, dites DEI.
Pourquoi?
Au cours des dernières décennies, les universités d’élite en particulier ont restreint les possibilités d’exprimer et de débattre des idées conservatrices. Les étudiants et étudiantes doivent pouvoir se sentir psychiquement et physiquement en sécurité, y compris en ce qui concerne les idées. La censure de certains a aussi été attisée par des étudiants qui ne voulaient pas se sentir mal à l’aise. Ce fut le cas de Linda Thomas-Greenfield, l’ambassadrice des Etats-Unis auprès de l’ONU, qui a mis son veto à trois résolutions appelant à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, ce qui lui a valu de nombreuses annulations d’invitations.
Cela touche à la liberté de pensée. Qu’en est-il des politiques DEI?
Nous avons le devoir de créer des conditions égales pour tous. Certaines mesures de protection sont nécessaires, comme celles destinées à la protection des personnes en situation de handicap ou neurodiverses ou à la prévention du suicide. Bien des mesures sont toutefois allées au-delà. L’Université de Virginie a engagé six personnes DEI pour 100 membres du corps enseignant pour 20 millions de dollars. C’était soit un mauvais investissement, soit un investissement idéologique – aujourd’hui, elle réduit drastiquement ce budget.
Vous approuvez donc la politiquede l’actuel gouvernement Trump?
Non, non, non! Mon devoir est de comprendre et d’expliquer les phénomènes, car ce n’est qu’ainsi qu’on peut trouver des solutions. Une adaptation du système universitaire des Etats-Unis était nécessaire à mon avis, mais cela va trop loin. Les agissements radicaux préoccupent également beaucoup d’intellectuelles conservatrices. Elles ne s’attendaient par exemple pas à des attaques contre les sciences naturelles et la recherche médicale.
Ces décisions imposées d’en haut affectent aussi la liberté académique.
Oui. Avant cette présidence, la liberté d’expression était déjà restreinte, mais cela émanait d’un consensus au sein de la communauté universitaire. Cela n’était pas imposé par des mesures aussi brutales et il était possible de critiquer ouvertement les restrictions. C’est là que réside l’ironie majeure de l’action du gouvernement: au nom de la liberté d’expression, il a restreint la liberté d’expression, d’idées et de recherche, et ce, avec des mesures pires encore que celles qu’il reproche à l’autre camp.
Quel est l’impact de cette politique sur place?
Elle est destructrice et contre-productive. La jeune relève, en particulier en sciences naturelles et en médecine, dépend du financement fédéral. De nombreux projets sont gelés parce qu’ils utilisent des mots-clés qui ne sont plus en vogue. Comme de nombreux accords de financement ne sont pas respectés, le gouvernement est aujourd’hui le partenaire le moins fiable qui soit. Des scientifiques de renom quittent le système américain ou prévoient de le faire. La dominance scientifique américaine est menacée. Elle représente la majeure partie du soft power du pays, la possibilité de fixer des thèmes de recherche.
La situation actuelle impacte-t-elle également votre travail?
Je n’ai pas de projets avec des collègues américains. Cela ne m’affecte qu’indirectement, car je m’exprime beaucoup sur la politique états-unienne. Je dis très ouvertement que je considère cette attaque contre la science comme grave et illégale, même si je comprends d’où elle vient. Si je rappelle la longue histoire dans laquelle elle s’inscrit, les gens pensent que j’approuve ces mesures. Ce n’est pas le cas. Mes collègues ne choisissent pas simplement de partir: ils travaillent, observent et commentent ce qui se passe. Cela devient problématique lorsqu’ils dépendent de fonds fédéraux.
Quatre professeurs américains n’ont pas souhaité donner une interview au sujet de l’antiscience aux Etats-Unis. Certains commentateurs affirment que la science s’arrange avec le nouveau gouvernement. Devraient-ils faire plus de bruit?
Beaucoup d’entre eux attendent certainement encore. On sait que l’administration Trump se montre souvent d’abord radicale, mais que des compromis sont possibles par la suite. Et le silence n’est pas total. Je vois beaucoup de mouvements et de commentaires, aussi de la part de hautes écoles conservatrices. Dans les institutions, nombreux sont ceux qui considèrent plus judicieux de s’adapter quelque peu.
Dans votre podcast «Grüezi Amerika», vous tirez des parallèles entre les démocraties américaine et suisse. La crise va-t-elle aussi toucher notre pays?
Je ne le pense pas. Le fossé entre le peuple suisse et les universités n’est pas si grand, et la méfiance et l’animosité envers le monde académique, moindre. La population suisse s’identifie plus, avec fierté, à ses institutions fédérales et à ses hautes écoles.