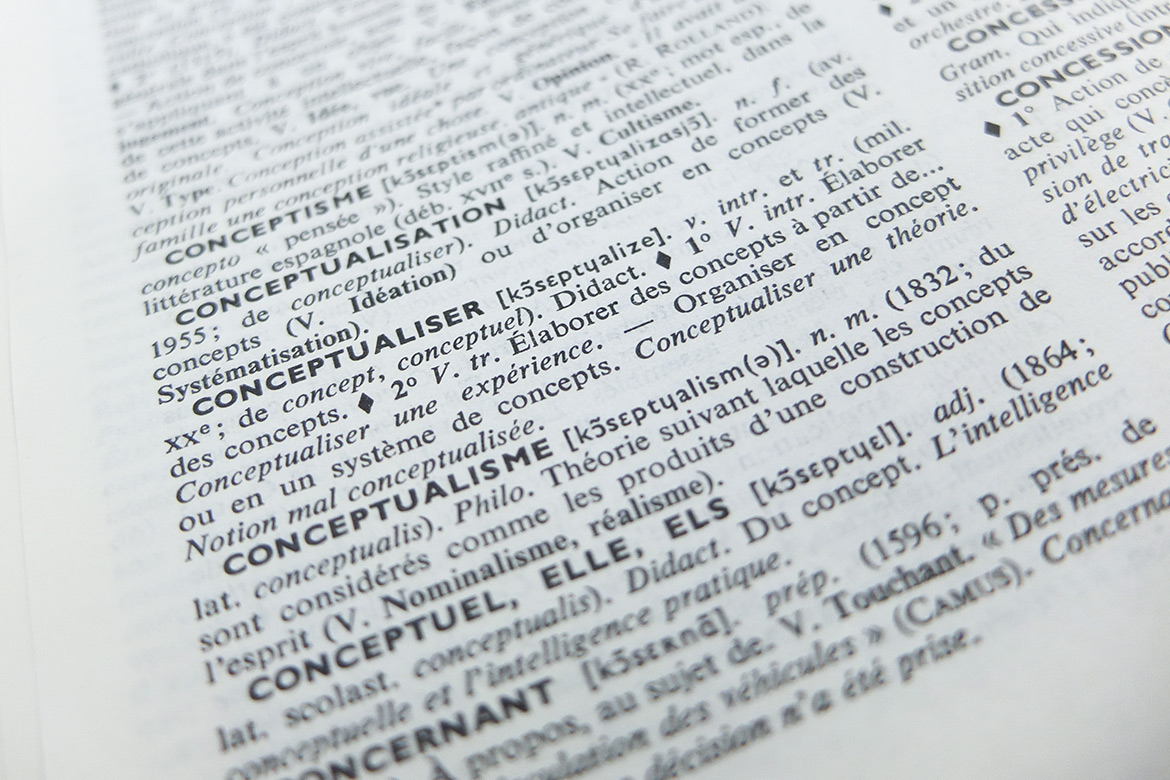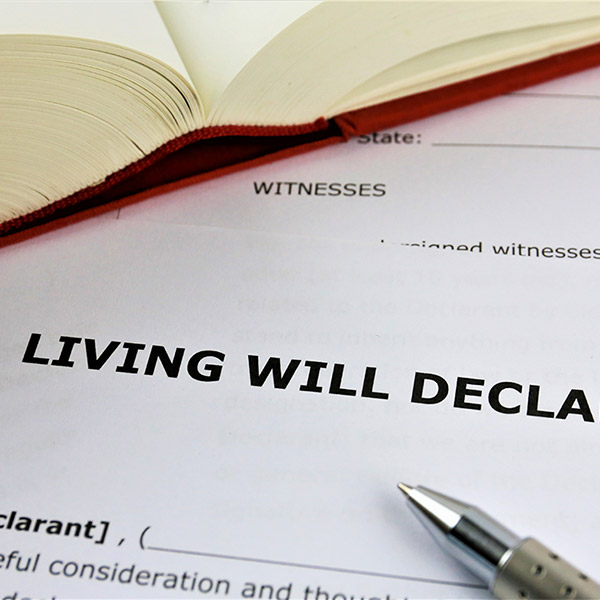REPORTAGE
Ici, on scrute le cerveau de la société
Au Laboratoire de recherche de l’Hôpital universitaire de Zurich, des scientifiques tentent de comprendre le raisonnement social d’une personne. Entre autres par le jeu feuille-cailloux-ciseaux. Nous participons.

Lorsque les scientifiques stimulent le cortex frontal à l'aide d'une bobine magnétique, les participants pensent plus vite et sont plus aptes à se mettre à la place des autres. | Photo: Markus Bertschi
Le sous-sol de l’Hôpital universitaire de Zurich est un labyrinthe de longs couloirs stériles. Un parfum de désinfectant flotte dans l’air. La haute porte en chêne plaqué détonne dans ce décor. Elle s’ouvre sur un laboratoire digne d’un hôtel de montagne – sans la vue grandiose. «Nous voulons étudier le comportement social. Pour cela, nous ne pouvons pas enfermer les gens dans une cave sombre», explique Christian Ruff.
Professeur en neuroéconomie et sciences de la décision à l’Université de Zurich, il est également directeur du Laboratoire de recherche sur les systèmes sociaux et neuronaux (SNS), créé en 2007. Sa mission: plonger dans le cerveau de la société. «Ici, nous cherchons à comprendre le fonctionnement des individus afin de pouvoir appréhender nos décisions et la société dans son ensemble», précise Christian Ruff. C’est ce qu’on appelle l’économie comportementale.
«Pendant des décennies, nous avons émis des hypothèses peut-être complètement fausses sur la société», note le chercheur. Par exemple: il y aurait automatiquement plus de fraudeurs si l’Etat tolérait la fraude fiscale. Car pourquoi être honnête si ce n’est pas exigé? A l’heure actuelle, personne ne sait si notre cerveau fonctionne réellement ainsi. «C’est pourquoi nous explorons les processus cérébraux responsables de nos actions. Notre objectif est d’établir des faits et de fournir un vocabulaire clair. Ainsi, nous découvrirons peut-être aussi ce que la politique, les organisations et les autorités peuvent faire pour que les gens se comportent différemment», explique-t-il.
Pour une étude systématique du comportement social, il faut une action sociale. Quelque chose de simple et qui peut être répété à volonté. Dans l’expérience prévue ce matin, le choix surprend: le jeu feuille-cailloux-ciseaux. Gökhan Aydogan, directeur de l’essai, vient de préparer un nouveau tour du jeu et a fait asseoir individuellement six jeunes femmes et hommes devant un écran.
La plupart des sujets recrutés étudient à Zurich. «Appuyez tous sur S, s’il vous plaît», demande-t-il. Les chiffres 1, 2 et 3 viennent remplacer les notions de feuille, cailloux et ciseaux. Le 3 bat le 2, le 2 le 1 et le 1 le 3. «Vous pouvez commencer à jouer.»
Comprendre les autres pour gagner
N’est-ce pas un peu puéril? «Non, estime Gökhan Aydogan, la partie en dit même long, car de nombreuses facultés particulières de raisonnement entrent en jeu. La plupart des personnes suivent une certaine stratégie ou des habitudes. L’une a par exemple une préférence pour le 1. Une autre joue surtout le chiffre qui l’a fait gagner la fois précédente. Ou elle joue systématiquement le chiffre suivant.»
Ce qui est décisif, c'est que les sujets doivent se mettre à la place de leur adversaire pour gagner. «Ils doivent comprendre comment fonctionne l’autre – une capacité essentielle. Nous en avons un besoin constant dans notre société – dans une relation de couple par exemple, mais aussi en politique, à l’école ou lors de négociations», explique Gökhan Aydogan. Les gens incapables de «lire» les autres perdent plus souvent. Il existe deux catégories de personnes: celles dont la capacité d’analyser les autres est excellente et celles qui en sont incapables. Ce dispositif expérimental permet de reproduire artificiellement cette configuration.
Une bobine magnétique est maintenant placée sur la tête des sujets. Elle émet des ondes électromagnétiques à une fréquence spécifique. En fonction de son positionnement sur le crâne pendant le jeu, elle stimule différentes zones du cerveau – par exemple le cortex frontal, responsable de la pensée logique et analytique. «Lorsque nous le stimulons, les gens sont capables de réfléchir plus vite et de mieux s’identifier aux autres, relève Marius Moisa, technicien et responsable de laboratoire. Ils gagnent alors plus souvent.»
En d'autres termes: ils deviennent un supercerveau social. Mais l’inverse est également vrai. La zone du cerveau concernée se fatigue si on modifie la cadence de stimulation. «Ces sujets perdent de leur capacité à lire leur adversaire et finissent par perdre», explique Marius Moisa.
Visualiser les zones cérébrales actives
Or, quel que soit le nombre de tours de jeu avec la bobine magnétique sur la tête, une chose manque toujours: la vue directe dans le cerveau. C’est là qu’intervient la pièce maîtresse du laboratoire: un appareil flambant neuf d’imagerie par résonance magnétique (IRM). «Nous avons dû abattre quelques murs pour le faire entrer», raconte Christian Ruff. A travers la vitre du centre de contrôle, le professeur jouit d’une vue directe sur l'appareil dans la pièce voisine. Allongée sur une table à roulettes, une jeune femme est poussée dans le tube, tête la première.
Peu après, son cerveau apparaît sur les écrans de contrôle sous forme de vues colorées, prises de face et de côté. Un écran fixé juste devant son visage lui permet de participer au jeu. D’une main, elle peut manier un curseur. «Le scanner mesure en temps réel les besoins en oxygène des diverses zones cérébrales. Cela nous permet de voir où exactement son cerveau est actif lorsqu’elle prend des décisions», explique Christian Ruff.
Les images font ensuite l’objet d’analyses statistiques. Les données disponibles sont désormais suffisamment nombreuses pour être en mesure de dégager un profil. «Nous disposons quasiment d’une empreinte digitale de la pensée sociale.» Le chercheur sait donc quelles zones sont actives lorsqu’une personne se met à la place d’une autre. «A partir de son profil d’activité, nous pouvons même prédire ses résultats au jeu.» Le taux de réussite atteint un fier 80%. A l’avenir, Christian Ruff aimerait utiliser ce type de prédictions en particulier chez les enfants pour identifier des troubles de l’apprentissage, mais aussi, entre autres, dans le spectre autistique.
La recherche sur le stress est un autre domaine d’application. Le Laboratoire SNS est en contact avec plusieurs réseaux de recherche en Suisse et dans le monde. «Nous aimerions un jour pouvoir mesurer directement, à l’aide d’un scanner cérébral, la résilience au stress d’une personne. On pourrait alors déterminer, dès le choix d’un métier, si quelqu’un est apte à devenir pompier ou policier.»
La recherche n’en est toutefois pas encore là, note Christian Ruff: «Nous devons d’abord comprendre comment le cerveau fonctionne sous stress. Certaines choses fonctionnent-elles mieux ou sommes-nous victimes du redoutable effet tunnel, soudain incapables de réfléchir?»
Les scientifiques ont recours à une astuce simple pour stresser les sujets: les mathématiques. La femme allongée dans l’IRM voit maintenant apparaître sur l’écran des exercices de calcul mental: 7 fois 9, le résultat divisé par 3, moins 4. Elle déplace le curseur sur le nombre 17 – et réussit de justesse! Trois secondes à peine et le calcul suivant apparaît déjà. Après quelques minutes, on a l’impression d’avoir passé toute une journée avec une cheffe râleuse sur le dos, qui veut à tout prix que l’on traite une tonne de dossiers avant minuit. Ainsi conditionnée, la participante reprend le jeu «feuille-cailloux-ciseaux».
Mieux comprendre la corruption
Malgré ses images en haute résolution, l’IRM est moins rapide que le cerveau humain: les scans ont toujours quelques secondes de retard. «Nous pouvons bien mesurer les zones d’activité cérébrale lors de la prise de décisions, mais la méthode n’est pas si précise en termes de temps», note Christian Ruff. C’est là qu’intervient le troisième élément clé du laboratoire: l’électroencéphalographie (EEG) qui mesure les ondes cérébrales en temps réel, à la milliseconde près à travers la boîte crânienne. Il manque certes de précision spatiale, mais combinées aux images de l’IRM, celles de l’EEG fournissent une représentation très précise des processus cérébraux.
«Notre recherche peut contribuer à rendre les processus sociaux plus efficaces.» Christian Ruff en est convaincu. Outre le choix professionnel, elle pourrait permettre d’améliorer les comportements éthiques en matière de consommation, de pollution ou de corruption. Sans oublier la dimension pathologique. «Dépression, troubles anxieux, borderline: ces étiquettes sont beaucoup trop imprécises.»
Là encore, il faudrait comprendre les mécanismes cérébraux fondamentaux. «J’espère que nous pourrons alors proposer des thérapies efficaces et améliorer la vie des personnes concernées.» Un premier jalon a déjà été posé au sous-sol de l’hôpital, grâce à l’alliance entre atmosphère hôtelière et technologie de pointe.