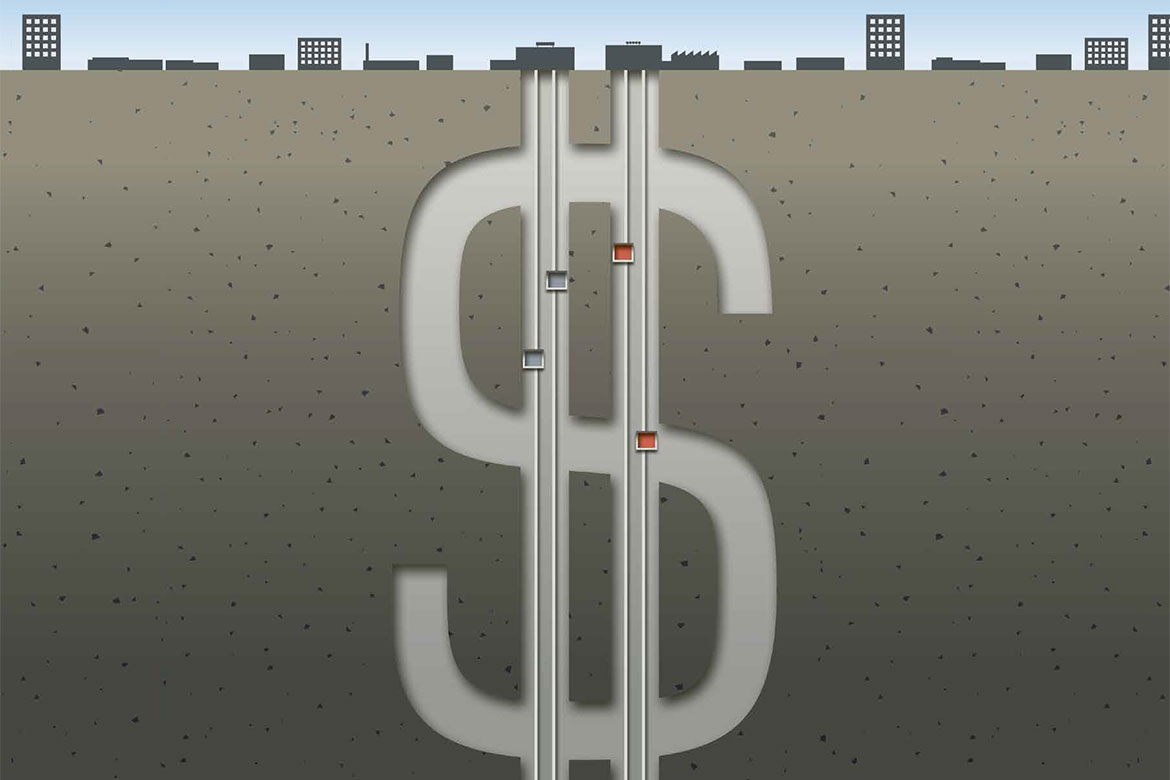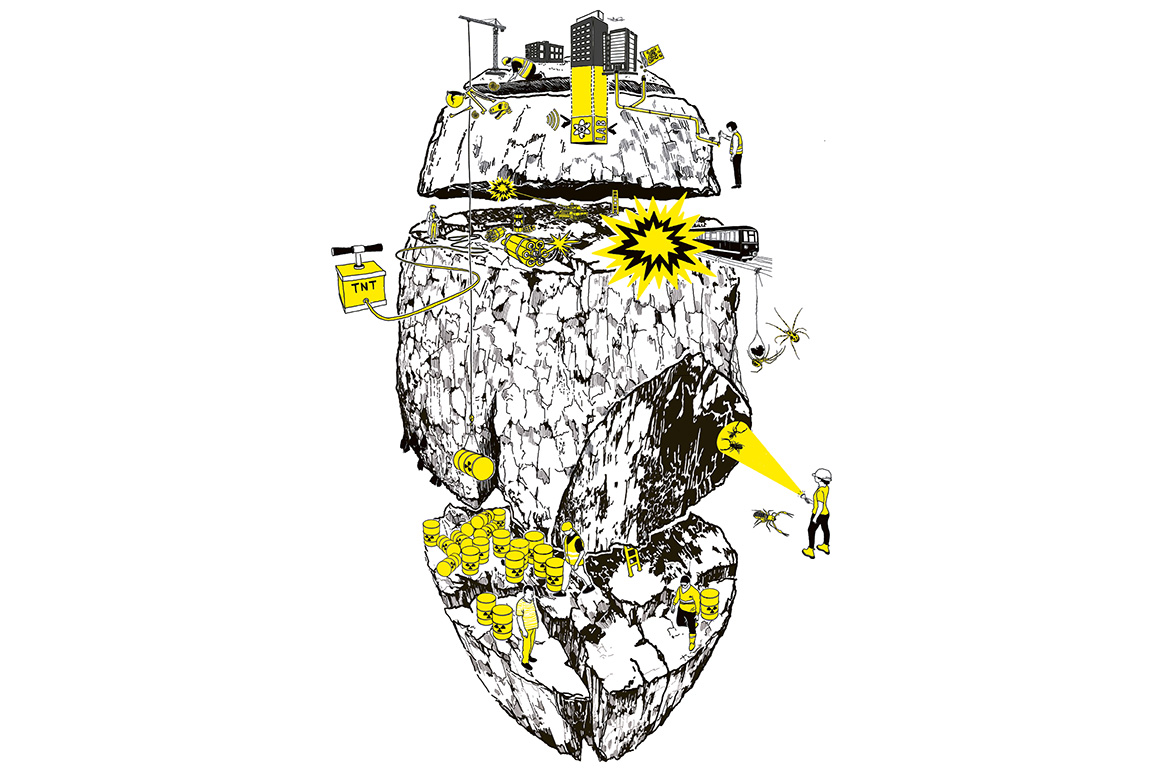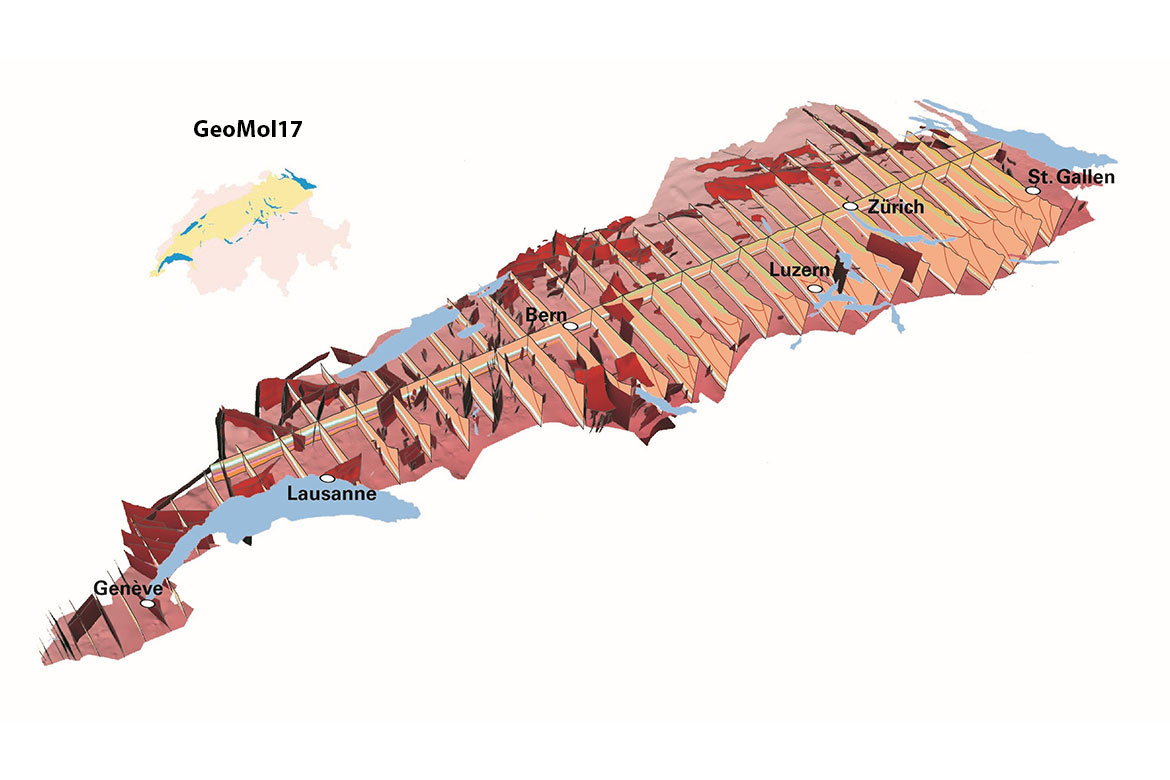NEUROPSYCHOLOGIE
Sous drogue au laboratoire
La neuropsychologue Katrin Preller met ses sujets d’étude sous LSD pour déterminer si la substance psychédélique pourrait servir à des fins thérapeutiques.

La chercheuse Katrin Preller refuse de dire si elle a testé sur elle-même les drogues dont elle étudie les effets. | Photo: Mara Truog
De prime abord, on pourrait penser que les activités menées dans le laboratoire de Katrin Preller à l’Université de Zurich sont contraires à la morale: la neuropsychologue administre du LSD à ses sujets d’expérience et analyse leurs réactions à la drogue récréative. L’expérience vise à trouver des pistes pour guérir des maladies telles que l’alcoolisme et la dépression. «Pendant mes études déjà, je me suis intéressée à ce qui pouvait influencer nos comportements et pensées sur le plan neurochimique. Des substances comme le LSD nous ouvrent une fenêtre sur la chimie du cerveau», explique-t-elle.
La chercheuse travaille dans un domaine délaissé par l’industrie pharmaceutique. D’une part, parce qu’il est très difficile de trouver de nouveaux médicaments contre la dépendance et la dépression et, d’autre part, parce que ces traitements ont souvent de graves effets secondaires. C’est pourquoi la recherche se tourne à nouveau vers le LSD, connu de longue date. Découvert par le chimiste suisse Albert Hofmann, ce principe actif a déjà été utilisé dans les années 1950 et 1960 pour traiter l’alcoolisme. «Les études de l’époque ne répondaient toutefois pas aux normes actuelles. C’est pourquoi on a longtemps ignoré si le LSD avait vraiment un effet thérapeutique», explique Katrin Preller. Les recherches avaient ensuite été rendues impossibles à cause du mouvement hippie et de la consommation incontrôlée de cette substance, dès lors interdite dans de nombreux pays.
Un regain d’intérêt n’est apparu qu’au tournant du siècle, des études modernes laissant entendre que le LSD pourrait bel et bien avoir un effet positif sur les dépendances et la dépression. Désormais équipés de scanners à résonance magnétique, les scientifiques étaient en mesure de suivre les effets de la drogue sur le cerveau.
Pas de conséquences négatives pour les participants
Ce sont principalement des étudiants qui se laissent mettre sous drogue au laboratoire de Katrin Preller. «La plupart veulent essayer une fois le LSD dans un environnement sûr, contrôlé et légal», rapporte-t-elle. Ne faut-il pas craindre qu’ils y prennent goût? «Non, affirme la scientifique. Les substances psychédéliques n’ont pas le moindre potentiel de dépendance. Par ailleurs, un check-up préalable vise à écarter toute personne à risque de psychose et de maladies cardiaques. Après ces tests, ils continuent aussi à faire l’objet d’une surveillance médicale et psychologique.» En plus de dix ans de recherche dans le domaine, la chercheuse n’a jamais observé de conséquences négatives à long terme pour les participants.
Pour ses tests, elle utilise surtout de la psilocybine, proche parente du LSD, issue des célèbres «champignons magiques». L’avantage: la substance a un effet limité à six heures, alors que celui du LSD peut durer jusqu’à vingt-quatre heures – ce serait une journée de travail très longue pour les participants et la directrice de l’essai.
En général, on administre une dose moyenne de 100 microgrammes de LSD ou de 15 à 20 microgrammes de psilocybine. Pendant qu’ils sont sous l’effet de la drogue, les participants doivent notamment répondre à des questions sur un ordinateur. On leur présente par exemple sur l’écran des visages exprimant des émotions variées. Le sujet doit attribuer des émotions à ces visages et dire pour lequel il ressent le plus d’empathie.
En combinaison avec les scanners du cerveau réalisés avec un tomographe, Katrin Preller peut ainsi cartographier le mode d’action de la drogue. Son constat: «Ces substances sont en mesure d’interrompre les modes de pensée ancrés dans le cerveau. Cela pourrait permettre aux personnes dépressives d’avoir une meilleure idée de leurs problèmes», dit la chercheuse. De plus, le LSD et la psilocybine renforcent les liens sociaux: «Les patients se sentent souvent isolés et coupés des autres. Le LSD pourrait les aider à réactiver leur environnement social, ce qui contribue donc à maîtriser leur maladie.»
A-t -elle déjà testé ces substances elle-même? «Je ne réponds jamais à cette question, dit-elle. Quelle que soit ma réponse, je ne m’en sors pas bien. Certains apprécieraient peut-être un oui. D’autres pourraient penser qu’une expérience personnelle est susceptible d’influencer la recherche.»