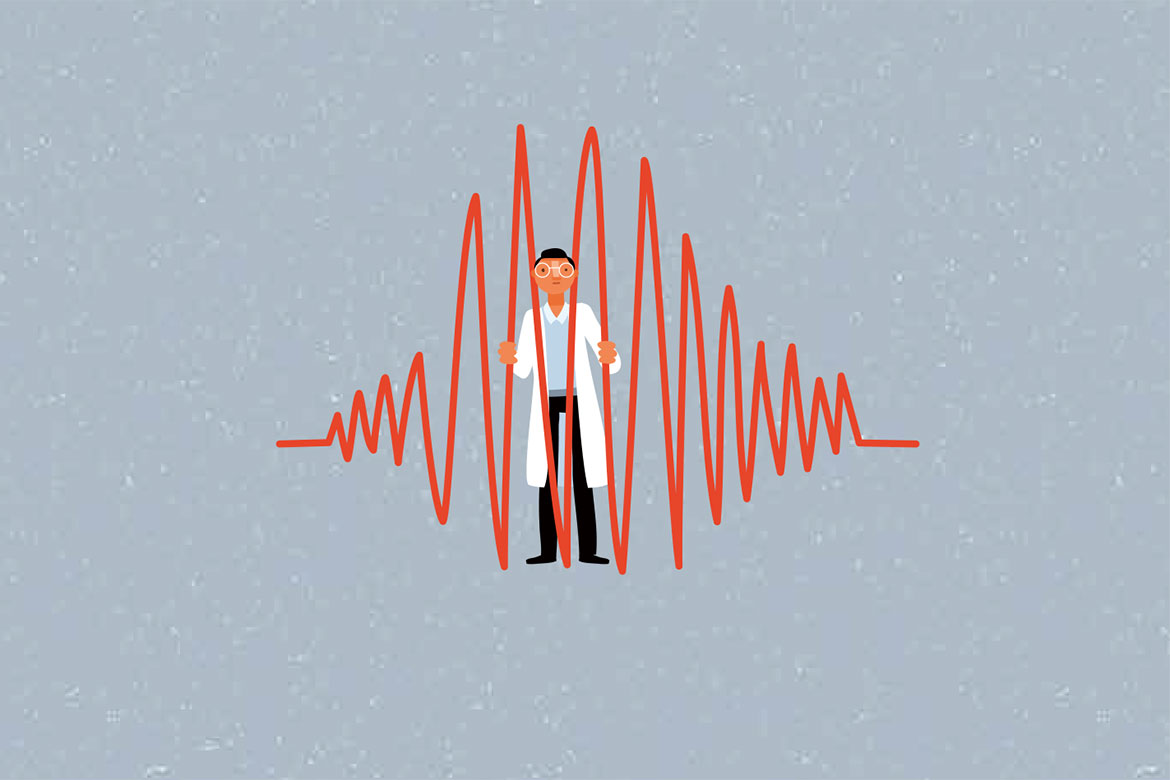Violence politique
Celui à qui les tortionnaires se confient
Pour Jonathan Austin, spécialiste de la violence politique au Proche-Orient, les tortionnaires sont des gens ordinaires qui se retrouvent pris dans un engrenage. Le sociologue cherche aujourd’hui à développer des outils pour enrayer la torture.

Il a perdu quelques amis durant la révolte en Syrie. Suite à cela, le politologue Jonathan Austin a tenu à comprendre à tout prix ce qui s'était passé dans ce pays et il a commencé à s'intéresser à la violence politique. | Image: Valérie Chételat
Un simple cahier et, sur une feuille blanche, une flèche verticale. A mi-hauteur, un trait horizontal, épais: la transition. En quelques coups de crayon, Jonathan Austin schématise le coeur des travaux qu’il mène au Graduate Institute à Genève: la dynamique individuelle de la violence politique. Soit le processus qui conduit une personne ordinaire à gravir différents niveaux jusqu’au seuil de transition, et à user de la torture sur d’autres.
Une orientation pas intentionnelle pour ce jeune sociologue politique d’origine anglaise, d’abord formé en langue arabe après une scolarité dans divers pays européens. Attiré par le Proche-Orient, il y séjourne entre 2007 et 2011 et y exerce notamment le métier de photographe freelance. Il finit par tomber amoureux de cette région: «J’ai vécu en Syrie, au Liban, en Palestine. Malgré le régime dictatorial, jusqu’au début de la révolution, la Syrie était alors un endroit très agréable, accueillant, avec une histoire extraordinaire, une nourriture variée, où différentes cultures cohabitaient et où il était facile de se faire des amis. Un vrai paradis», se remémore-t-il. Or en très peu de temps, tout s’effondre, devient cauchemardesque. «Certains de mes amis sont morts dans la révolte. J’ai eu à coeur de comprendre ce qui s’était passé», expliquet- il. C’est donc presque naturellement qu’à son retour il oriente son cursus vers la thématique de la violence dans cette région.
La violence banalisée
Dans le cadre de son récent doctorat, il axe plus particulièrement ses recherches sur la torture pratiquée par les forces gouvernementales – policiers, conscrits ou militaires. Une forme de violence généralement interdite dans les législations mais encore largement pratiquée. Le chercheur se rend à nouveau au Proche-Orient pour interroger des tortionnaires dans des camps de réfugiés et comprendre par quels mécanismes ils en arrivent à commettre de tels actes. Il obtient facilement des informations: dans ces pays, la violence est banalisée, en parler n’est pas tabou. Il s’aperçoit également que ces personnes capables de violence sont finalement des gens ordinaires. «Ce ne sont pas des professionnels de la torture», explique-t-il. Et d’ajouter: «Les gens ne sont pas des monstres. Dans l’immense majorité des cas, ils ne cherchent pas délibérément à faire du mal.»
Il constate qu’ils se trouvent pris dans un engrenage, dans des automatismes. Lorsque la violence est quotidienne, quand on punit par exemple ses enfants en leur frappant la plante des pieds – la falaka, un châtiment corporel courant au Proche-Orient – il n’est pas si difficile de répéter le même geste sur un suspect lors d’un interrogatoire. «Aux Etats-Unis, par contre, la torture prend plutôt la forme de rituels sportifs, tels que des jeux de football où l’on rentre dans l’autre. Ici aussi, le tortionnaire reproduit quelque chose de connu et l’aspect ludique le dédouane », illustre-t-il. L’effet de groupe joue par ailleurs un rôle important: il est plus facile de s’en prendre à quelqu’un à plusieurs que seul. Dans certains cas, drogue et alcool contribuent également à oublier la réalité des gestes. Et la limite entre innocence et violence est alors facilement franchie.
Cette acceptation progressive de la violence, le chercheur l’a d’ailleurs lui-même expérimentée. «Lorsque j’interviewais les tortionnaires, on parlait de torture en termes techniques, on regardait des vidéos ensemble en mangeant, sans émotion, sans réaction. Je n’avais pas de problème pour m’endormir le soir, la torture était devenue une routine. En fait, il m’a fallu plus d’une année pour prendre conscience que je commençais moi-même à suivre ce processus! » A posteriori, le chercheur se souvient qu’il s’était mis à fumer beaucoup plus. Un moyen, sans doute, d’évacuer un mal-être tout de même présent. «Les tortionnaires fument énormément», relève-t-il.
Depuis, le sociologue a trouvé des moyens pour prendre du recul sur son thème de recherche. Il travaille ponctuellement sur la torture mais fait des pauses régulières. Ses autres thèmes de prédilection, comme la littérature arabe, lui offrent une échappatoire bienvenue. Il apprécie particulièrement la poésie arabe pour son esthétique.
La violence politique reste tout de même le principal domaine de recherche de Jonathan Austin. Il dirige depuis 2017 l’Initiative pour la prévention de la violence au Centre sur les conflits, le développement et la consolidation de la paix, un centre de recherche interdisciplinaire du Graduate Institute. Il essaie, dans ce cadre, de proposer des outils pour enrayer la violence. Selon ses recherches, améliorer l’environnement matériel pourrait y contribuer en perturbant les mauvais automatismes – de la même manière qu’une meilleure conception des routes contribue à favoriser la fluidité du trafic. Quand la nourriture manque, que l’électricité fait défaut, que les tortionnaires dorment dans une pièce avec les prisonniers, le niveau de stress augmente et avec lui le risque de débordements. Il croit notamment au potentiel des équipements de surveillance type «boîtes noires». Savoir que l’on est surveillé nous replace, en quelque sorte, face à nos actes, assure-t-il.
Installé à Genève, Jonathan Austin y apprécie la ponctualité et le calme suisses. Au vu du Brexit, il a ajouté le passeport irlandais à ses bagages, pour ne pas se fermer d’éventuelles portes pour la suite de sa carrière. «Mais j’aimerais bien rester en Suisse», ajoute-t-il. Toujours attaché au Proche-Orient – dans son bureau, objets et tapis en témoignent – il se dit optimiste pour cette partie du monde. «Même si la situation actuelle sur place est terrible, elle représente pour moi l’expression d’un désir de changement. J’ai beaucoup d’espoir pour ces peuples.»