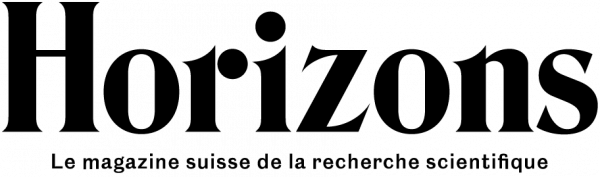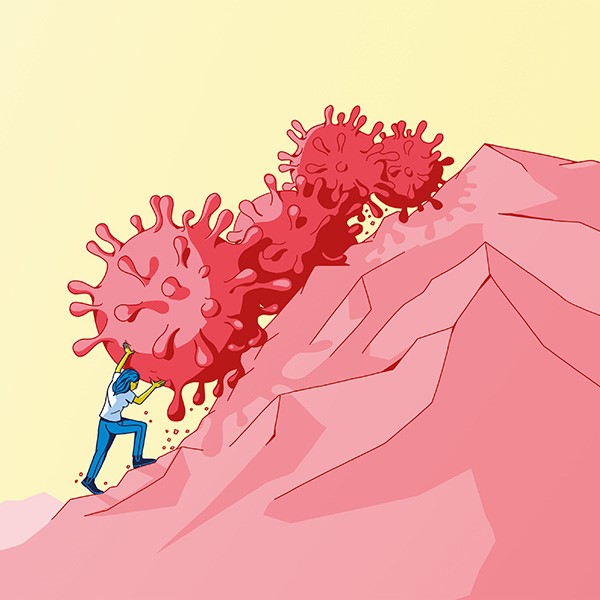MALADIES INFECTIEUSES
Après la pandémie, c’est avant la pandémie
Le monde était mal préparé à la propagation rapide du coronavirus. Ce que la Suisse pourrait mieux faire la prochaine fois.

La grippe aviaire provoquera-t-elle une nouvelle pandémie chez l’être humain? Les scientifiques ne peuvent pas le prédire, mais ils peuvent se préparer à cette éventualité. | Photo: Keystone / Magnum Photos / Cristina de Middel
«C’est évident qu’une nouvelle pandémie surviendra. La question est de savoir dans combien de temps», résume Kaspar Staub. Il semble toutefois que l’intervalle entre les pandémies se raccourcisse, note l’historien et épidémiologiste à l’Institut de médecine évolutive de l’Université de Zurich. Il travaille notamment sur les épidémies du passé.
Et le prochain agent pathogène pourrait être...
Pathogène X: c’est ainsi que les spécialistes appellent l’agent infectieux encore inconnu de la prochaine pandémie. Les candidats comprennent la grippe et les coronavirus, mais également des virus moins connus, comme l’hantavirus répandu chez les souris. Autre possibilité: un tout nouvel agent pathogène.
La prochaine pandémie sera probablement une zoonose, avec un agent qui passe de l’animal à l’humain, s’accordent à dire la plupart des spécialistes. Le plus grand danger vient des virus respiratoires qui se transmettent par l’air, tel le SARS CoV- 2, et non par contact avec la peau, comme la variole du singe. Certains virus sont surveillés et les cas de maladie sont suivis ou les gènes séquencés, afin de détecter à temps les mutations dangereuses pour l’humain. «Mais nous n’avons pas les capacités nécessaires pour surveiller tous les virus à grande échelle», souligne la virologue Silke Stertz de l’Université de Zurich.
Actuellement, la grippe aviaire, qui s’est propagée aux vaches aux Etats-Unis, figure en tête de liste des préoccupations. Quelques humains ont également été infectés. Toutefois, Silke Stertz donne le signal provisoire de fin d’alerte: la contamination ne serait possible qu’à forte dose de virus en cas de contact étroit avec des vaches. Le virus ne présente encore aucune mutation rendant possible la transmission entre humains. «Cela ne signifie pas que cette adaptation ne se produira pas à un moment donné», précise-t-elle.
Ses recherches le prouvent: pendant une pandémie, la Suisse a peu de difficultés à générer de l'attention et mobiliser des ressources pour la combattre. Mais les choses se compliquent dès la crise surmontée. Les spécialistes appellent cette perte de mémoire collective «Katastrophenlücke», ou «lacune de catastrophe». Pour Kaspar Staub, il est bien entendu compréhensible que les gens ne vivent pas constamment en état d’alerte, «mais c’est justement pourquoi nous devons créer une base de connaissances et des ressources dès maintenant – pour que certaines données soient prêtes lorsque la prochaine pandémie surviendra», souligne-t-il.
A l’Université de Berne, l’équipe de l’épidémiologiste Nicola Low commençait déjà à préparer la prochaine pandémie quand sévissait le Covid-19, car des lacunes sont alors apparues de manière flagrante. «Nous ignorions par exemple le nombre et la fréquence des contacts entre les gens en Suisse», explique-t-elle. Ce genre d’information est crucial, notamment pour modéliser les contaminations et offrir une base de décision pour les mesures possibles: l’obligation du port du masque est-elle effectivement utile? La fermeture des écoles est-elle vraiment nécessaire?
Une cohorte prête en cas d’urgence
«Sans valeurs de référence, nous volons à l’aveuglette», explique Nicola Low. Au Multidisciplinary Center for Infectious Diseases, son équipe a donc lancé l’étude de cohorte Beready, centrée sur la préparation à une pandémie. Unique en Europe et soutenue par la fondation suisse Vinetum, l’étude veut recruter 1500 ménages du canton de Berne. Après un premier examen médical, l’équipe collecte des informations sur certaines pathologies à l’aide de questionnaires et d’échantillons sanguins annuels, prélevés par les participantes et les participants eux-mêmes au bout d’un doigt. Ainsi, les scientifiques peuvent par exemple suivre comment diverses maladies infectieuses se propagent au sein d’une famille. Les animaux domestiques sont aussi inclus, car les agents pathogènes se transmettent souvent de l’animal à l’homme et inversement.
De plus, la cohorte bernoise doit servir de force d’intervention rapide en cas de pandémie. L’équipe disposerait déjà d’un groupe bien caractérisé de participantes et participants pour identifier les corrélations importantes presque en temps réel. Par exemple: si des anticorps déjà présents dans le sang protègent contre le nouvel agent pathogène.
Mais il n’y a pas que les facteurs humains qu’il s’agit de mieux comprendre. On en sait également trop peu sur les agents pathogènes. Lors de la pandémie de Covid-19, il n’avait nullement été anticipé que les personnes infectées puissent être contagieuses autant de temps avant l’apparition des symptômes. Les plans de pandémie suisses étaient fondés sur la grippe, pour laquelle ce délai est plus court. Que le SARS-CoV-2 se propage efficacement par voie aérienne était également inattendu. «Une infection par aérosols est très difficile à endiguer», souligne la virologue. Mais la compréhension de ce processus étant encore très lacunaire, il est difficile de développer des contre-mesures efficaces.
C’est pourquoi elle avait déjà mis au point un dispositif pour produire des gouttelettes infectieuses avant la pandémie de Covid-19. Réalisé en collaboration avec une équipe de l’EPFL et de l’ETH Zurich, celui-ci permet d’étudier par exemple l’effet de la composition de l’air ambiant sur la survie des virus. «Une fois que nous aurons compris le principe, nous espérons que de nombreuses voies de lutte contre les infection s'ouvriront», souligne la chercheuse.
Plus rapidement vers un vaccin
Des contre-mesures adéquates peuvent ralentir la progression d’une pandémie à son début. Le meilleur moyen de l’arrêter reste toutefois la vaccination. «Dans le cas du SARS-CoV-2, il n’a fallu que 326 jours entre le séquençage du virus et le déploiement du vaccin. Ce fut incroyablement rapide», souligne Aurélia Nguyen, directrice adjointe de la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), une ONG basée à Oslo. Lors de la prochaine pandémie, un vaccin devrait être disponible en moins de cent jours, selon la CEPI. «Cela sauverait d’innombrables vies humaines et ferait une différence fondamentale dans l’évolution de la situation», dit la spécialiste en santé publique. Le plan est ambitieux, d’autant plus que personne ne sait quel agent infectieux sera à l’origine de la prochaine pandémie (lire encadré ci-dessus).
C’est pourquoi la CEPI poursuit des approches diversifiées afin d’identifier les familles de virus les plus dangereuses, basées sur l’IA et sur d’autres méthodes. L’ONG préconise le développement de vaccins pour les membres connus de ces familles. «En cas de pandémie, il n’y aura plus qu’à introduire dans ces vaccins préparés le composant correspondant au virus spécifique», poursuit la directrice adjointe.
D’autres mesures comprennent la préparation d’études cliniques, la concertation avec les autorités de régulation ainsi que la mise en place de sites de production dans le monde entier, y compris les pays du Sud global. L’ONG ne mise pas uniquement sur les vaccins à ARNm. Ceux-ci présentent certes de nombreux avantages, comme un développement et une production rapides, mais ils ont des limites, tel le besoin d’une chaîne du froid ininterrompue, selon Aurélia Nguyen.
D’autres types de vaccins pourraient offrir une protection plus durable. La chercheuse considère aussi comme prometteuse la recherche sur les vaccins immunitaires agissant contre une grande partie de la grippe, des coronavirus ou d’autres familles. Leur effet ne serait peut-être pas toujours optimal, mais devrait suffire en attendant qu’un vaccin spécifique soit disponible.
Plus seulement la grippe
Les préparatifs ne sont certes utiles que s’ils sont appliqués en cas de pandémie. L’adoption, en mai 2025, de l’accord de l’OMS sur les pandémies constitue un signe encourageant, selon Aurélia Nguyen. Les pays membres s’y engagent notamment à coopérer en matière de chaînes d’approvisionnement et à échanger des informations. Les Etats peuvent néanmoins continuer à décider souverainement de mesures telles qu’un confinement.
Le gouvernement suisse s’emploie également à mettre en œuvre les enseignements tirés de la dernière pandémie. En juillet dernier, le Plan national de lutte contre la pandémie révisé a été publié. Contrairement au précédent, celui-ci ne se concentre plus uniquement sur la grippe, mais également sur les virus respiratoires en général. Autre nouveauté: son format en ligne, qui permettra d’effectuer des mises à jour et des adaptations en continu.
Reste encore à voir dans quelle mesure les nouvelles connaissances scientifiques seront effectivement prises en compte dans la lutte contre la prochaine pandémie. «Nous pouvons générer des données, mais c’est la politique qui décide en fin de compte de ce qu’on en fait», rappelle Eva Maria Hodel, cheffe de projet de Beready. En attendant, son équipe s'emploie en tout cas à entamer dès maintenant un dialogue avec les décideurs et à établir des contacts.