L'OPINION DE LA RELÈVE
«Mon permis de travail est lié à mon employeur»
Chercheuse à Lausanne et originaire du Liban, une spécialiste de l’IA pour les diagnostics de tumeurs pointe les obstacles auxquels les scientifiques de pays tiers font face en Suisse.
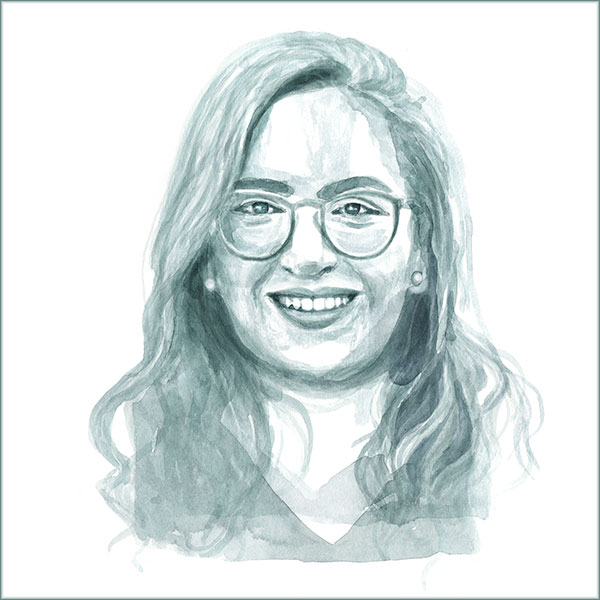
Rita Sarkis travaille en pathologie digitale et transcriptomique spatiale à l’Institut universitaire de pathologie du CHUV. Elle a présidé l'ELSA de l’EPFL jusqu'en 2023. | Illustration: Stefan Vecsey
Dans ma recherche, nous développons des outils d’intelligence artificielle et d’imagerie de cellules et de tissus pour améliorer le diagnostic des tumeurs. Ce secteur exige une expertise hautement spécialisée et rare. En tant que scientifique venant du Liban, un pays étranger non membre de l’UE et l’AELE (pays tiers), travailler en Suisse est une opportunité précieuse, mais semée d’embûches, même après un parcours académique dans une institution fédérale.
Mon permis de travail est lié à mon employeur, rendant chaque transition professionnelle incertaine. Au-delà des qualifications requises, il faut naviguer à travers une bureaucratie complexe qui fait de chaque évolution de carrière un véritable défi. Si les instituts de recherche recrutent plus volontiers des scientifiques de pays tiers, les hôpitaux, pourtant à la pointe de la recherche et de la médecine de précision, hésitent à s’engager dans ces démarches. Pour l’employeur, prouver qu’aucun candidat suisse ou européen ne peut occuper le poste est un processus long et dissuasif.
Au-delà des barrières formelles, être une chercheuse de pays tiers en Suisse signifie aussi évoluer sous une pression constante liée à ce statut. La précarité administrative s’accompagne d’un sentiment latent de discrimination, renforcé par l’attitude de certains services RH et administratifs. On nous rappelle trop souvent que notre situation représente un «effort supplémentaire » pour l’institution, comme si notre présence relevait d’une faveur plutôt que de notre contribution légitime.
Les restrictions en Suisse pour les chercheuses et chercheurs issus de pays tiers empêchent le marché du travail de les orienter vers les entreprises qui ont besoin de leurs compétences. Et génèrent une inégalité dans les chances d’évolution. Face à ces obstacles, plusieurs de mes anciens collègues ont renoncé à poursuivre leur carrière ici, malgré des opportunités scientifiques. Ainsi, ces régulations inadaptées aux besoins réels du secteur limitent la diversité, freinent l’innovation et compliquent l’intégration des avancées technologiques en milieu hospitalier. Si la Suisse veut rester un pôle d’excellence compétitif, elle doit assouplir les critères d’embauche pour les scientifiques de pays tiers.



