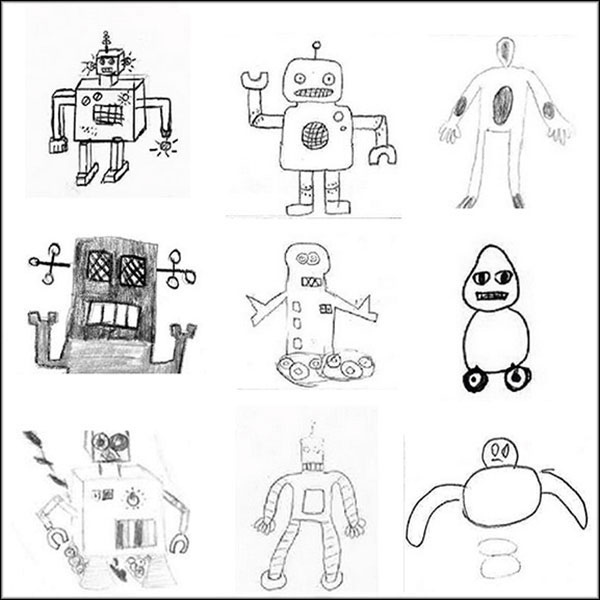RECHERCHE EN NUTRITION
L’odyssée d’une étude sur les édulcorants en Iran
Le sucre rend malade. Une étude clinique menée en Iran devait enfin clarifier les effets des substituts sur la santé. Comment une bonne idée s’est empêtrée dans les méandres des sanctions économiques.

Le régime sucré occidental arrive de plus en plus en Iran, mais l’argent de la recherche occidentale ne peut pas franchir la frontière à cause des sanctions économiques internationales. | Photo: Kaveh Kazemi / Getty Images
Pour Hamidreza Raeisi-Dehkordi, décembre 2022 fut un mois difficile. Il avait consacré deux ans à préparer une étude clinique, pour finalement assister à son enterrement. Auparavant, le jeune chercheur iranien avait obtenu un Master en sciences de la nutrition dans la ville de Yazd, à quelque 250 kilomètres au sud-est d’Ispahan. Il voulait étudier l’effet des édulcorants chez les femmes souffrant d’obésité durant la ménopause. Avec l’aide de son directeur de thèse de master, il avait rédigé sa demande de subvention au programme Spirit du Fonds national suisse, qui soutient des collaborations de recherche avec le Sud global et met un accent particulier sur la sensibilisation aux questions de genre.
Le plan était de venir à Berne en février 2021 pour y effectuer l’analyse scientifique. Mais la pandémie de covid l’empêcha d’obtenir un visa. «C’était une situation difficile, raconte le chercheur. Je travaillais sans salaire, vivais chez mes parents et devais faire le service militaire obligatoire parce que je n’avais pas trouvé d’emploi immédiatement après mes études.» En décembre de la même année, tout s’arrangea enfin. Pendant deux ans, il s’occupa de tout préparer en Iran et en Suisse: le protocole d’étude, les autorisations de la commission d’éthique et de l’Université de Yazd. Mais il ne devait pas en être ainsi.
Pourtant, l’étude aurait été très importante pour plusieurs raisons: la surconsommation mondiale de sucre provoque des caries, l’obésité et toute une série de maladies chroniques dont le diabète de type 2. L’industrie alimentaire et la population misent donc sur des édulcorants tels que l’aspartame, la saccharine et la stévia. Mais leurs effets sur la santé sont controversés. En 2024, l’OMS a même classé l’aspartame comme «potentiellement cancérigène». Cela avait suscité une vive polémique. Les connaissances scientifiques à ce sujet sont insuffisantes: les mécanismes du métabolisme sont avant tout connus grâce à des études menées sur des animaux, et ne peuvent être transposés à l’être humain que de manière limitée. En outre, les études d’observation réalisées chez les humains ne permettent pas de stinguer clairement entre les causes et les effets.
La ville iranienne de Yazd, terrain idéal
«Nous savons que l’obésité est associée au diabète de type 2», explique Angéline Chatelan, professeure d’épidémiologie nutritionnelle à la Haute école de santé de Genève. Par contre, on ne sait pas exactement quel rôle précis joue le sucre, ni si les édulcorants sont vraiment meilleurs. C’est pourquoi elle a conçu l’étude clinique avec le doctorant Hamidreza Raeisi Dehkordi et une équipe de recherche. L’objectif était de tester les effets de l’aspartame, de la saccharine, de la stévia et du sucre de table sur les bactéries intestinales, ainsi que sur le poids, la glycémie, les marqueurs de la santé cardiovasculaire et les hormones sexuelles. Au total, 160 Iraniennes ménopausées et souffrant d’obésité ont reçu chaque jour un flacon d’une solution aqueuse contenant l’édulcorant qui leur avait été attribué, raconte la chercheuse.
«Il faut différencier les effets de l’édulcorant de ceux du cycle menstruel.»Angéline Chatelan
Les femmes sont globalement sous-représentées dans les études cliniques, car se baser sur des hommes est souvent plus facile. Cela est également lié aux hormones, explique Angéline Chatelan en prenant l’exemple de sa propre étude qui a échoué: «Il faut différencier les effets de l’édulcorant de ceux du cycle menstruel. De plus, de nombreuses femmes prennent la pilule contraceptive.» Coordonner les prélèvements de sang, d’urine et de selles avec le cycle de chaque participante – comme prévu dans l’étude – aurait représenté un trop grand défi pour le personnel hospitalier. Une option intéressante était donc de travailler avec des femmes ménopausées, qui ont cessé d’avoir leurs règles. Elles consomment certes moins d’édulcorants que les femmes jeunes – les principales consommatrices –, mais elles présentent un risque accru de développer une surcharge pondérale.
L’étude devait être menée en Iran, car «les pays du Moyen-Orient font partie des plus touchés par les problèmes de surpoids», dit l’épidémiologiste. A Yazd, environ la moitié des femmes ménopausées souffrent d’obésité. De plus, les édulcorants n’y sont pas encore aussi répandus qu’en Suisse, par exemple. C’est donc un terrain propice pour étudier de petits effets sur les bactéries intestinales. Les sciences de la nutrition sont aussi très développées en Iran. Amin Salehi-Abargouei, partenaire iranien du projet et professeur à l’Université des sciences médicales Shahid Sadoughi à Yazd, le confirme: «Les sciences nutritionnelles sont enseignées en Iran depuis 1961.» Il parle de 46 départements, 23 centres de recherche et 2100 publications par an sur le sujet.
Les conditions auraient donc été idéales. Les sanctions économiques internationales ont cependant fait capoter le projet: il n’existait aucun moyen légal de transférer de Suisse en Iran les 20 000 francs destinés aux salaires du personnel de l’étude clinique. Ce fut une grande déception pour Amin Salehi-Abargouei: «Je suis d’avis que les questions politiques et l’embargo ne devraient pas affecter la recherche, et en particulier les collaborations scientifiques portant sur la santé.»
Pour le doctorant Hamidreza Raeisi-Dehkordi, il y allait aussi de son emploi. Après deux ans de préparation, il se trouvait désormais bloqué à Berne, sans projet de recherche. L’équipe qui l’encadre – Angéline Chatelan, Amin Salehi-Abargouei et Oscar H. Franco, professeur de santé publique à l’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Berne – lui en a donc proposé un autre qui porte sur les hormones sexuelles ainsi que sur la santé cardiovasculaire chez les femmes.
L’étude aurait été si importante
Pour le jeune Iranien, l’étude sur les édulcorants devenait secondaire. L’équipe, elle, ne l’a pas abandonnée et a décidé de se concentrer sur deux projets dérivés. Dans le premier, un travail de synthèse des études existantes a été effectué pour rassembler les connaissances disponibles sur les liens entre édulcorants et maladies. Résultat: les édulcorants puissants sont bel et bien associés à un risque plus grand de diabète, de maladies cardiovasculaires et de divers cancers. «Il faut toutefois noter que ces corrélations ne sont pas de grande ampleur», écrit l’équipe. Angéline Chatelan souligne qu’«on ne sait pas ce qui vient d’abord: les gens qui consomment le plus d’édulcorants sont probablement déjà en surpoids».
C’est précisément pour éviter de telles corrélations trompeuses que l’étude clinique en Iran aurait été nécessaire. Analyser les données des cohortes existantes était désormais la solution la plus proche. Le second sous-projet tire ainsi parti d’une étude qui documente systématiquement depuis 2011 le mode de vie et la santé de près de 25 000 personnes vivant à Amsterdam. Avec son directeur de thèse Oscar Franco, Hamidreza Raeisi-Dehkordi a déménagé de Berne à Utrecht aux Pays-Bas, notamment pour se rapprocher de la cohorte.
La cohorte d’Amsterdam était la seule dont le groupe pouvait obtenir les données dans un délai raisonnable. «L’open science n’est pas toujours très open», explique Angéline Chatelan. Selon elle, les responsables de ce type d’études souhaitent souvent publier d’abord leurs propres résultats. Et la protection de la sphère privée des patientes et des patients rend les procédures fastidieuses. A cela s’ajoute une pénurie de spécialistes pour l’analyse des bactéries intestinales en Europe. L’étude réalisée avec les données des Pays-Bas n’a pas encore été publiée, mais l’épidémiologiste confie néanmoins son impression: «Mon intuition me dit que nous ne pouvons pas affirmer que le microbiome intestinal est influencé par les édulcorants.» Mais même si cela était clair, il faudrait encore démontrer que les bactéries intestinales sont réellement responsables de l’augmentation du risque pour la santé. Ce n’est qu’alors que le lien de causalité serait complet», indique-t-elle.
Tirer une conclusion définitive exigerait de mener une étude clinique comme celle initialement prévue. «En réalité, il faudrait étudier les effets de chaque édulcorant, à court terme, immédiatement après l’ingestion, mais aussi à long terme», note Anne Christin Meyer-Gerspach, codirectrice de la recherche sur l’obésité, le diabète et le métabolisme au Claraspital de Bâle. Elle estime que «le projet en Iran aurait été formidable. Il aurait enfin permis de mener une étude d’intervention auprès du groupe qui nous intéresse précisément.» Elle souligne toutefois que le sucre reste nettement plus nocif que les édulcorants courants. L’OMS fixe des exigences de sécurité très strictes pour ces derniers. Elle en est donc convaincue: «Il faudrait tout d’abord réduire de façon générale la saveur sucrée des produits. Ensuite, nous pourrions remplacer dans des proportions moindres le sucre restant par des alternatives comme les édulcorants.»
Seul Hamidreza Raeisi-Dehkordi s’occupe encore de la dernière partie du projet, liée à la cohorte restante d’Amsterdam. A cause des retards dus aux problèmes de visa, il a encore le temps de la finaliser et de la publier. Elle constituera au moins une partie de sa thèse.