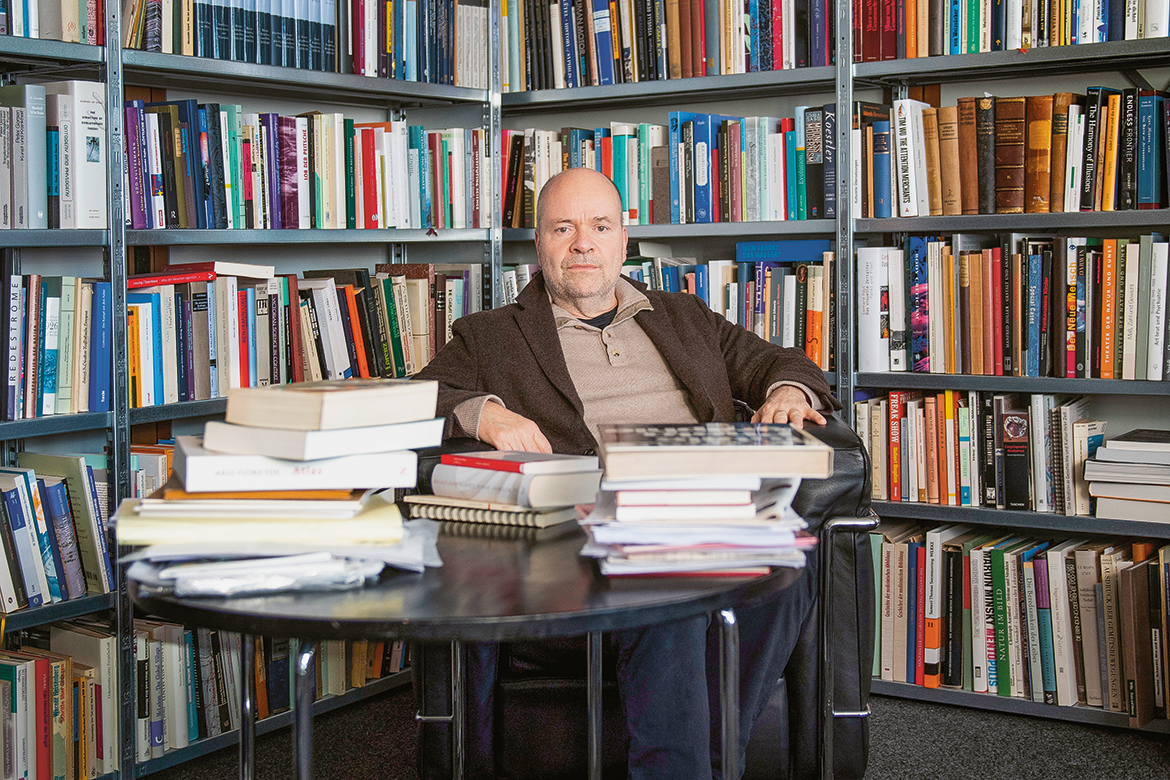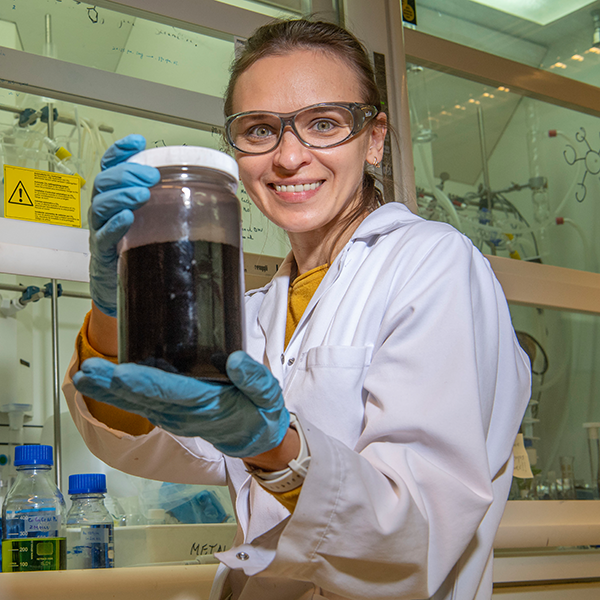DOSSIER: IMPLICATION PERSONNELLE
«C’est plus facile en sciences naturelles»
En fin de compte, est-ce au résultat d’être objectif ou surtout au processus pour y parvenir? Le philosophe des sciences Jan Sprenger explique les principes fondamentaux de l’objectivité dans la recherche. Et pourquoi cela est plus simple en sciences naturelles.

Lorsque les philosophes formulent des hypothèses, celles-ci ne sont bien sûr pas faciles à vérifier empiriquement, explique Jan Sprenger, spécialiste en philosophie des sciences. | Photo: Bea De Giacomo
Jan Sprenger, vous vous intéressez à l’objectivité et à la subjectivité dans la recherche d’un point de vue philosophique: à quoi devrait prêter attention quelqu’un qui a une expérience personnelle avec l’objet de sa recherche?
Nous distinguons deux dimensions en philosophie des sciences: les expériences ou les perspectives personnelles sont admissibles lors de la formulation d’une hypothèse. L’évaluation de cette dernière à l’aune des preuves fournies doit toutefois se faire selon les standards usuels de la discipline. De plus, le vécu personnel ne doit pas servir de preuve pour confirmer certaines théories. Et il faut, bien sûr, veiller à ce qu’il n’obscurcisse pas le jugement.
Tout dépend donc du stade auquel l’expérience personnelle intervient dans l’acquisition des connaissances.
Oui. Cela vaut d’ailleurs également pour notre propre conception du monde.
A quel point pensez-vous être objectif dans vos réflexions sur l’objectivité?
Eh bien, pour nous, philosophes, tester empiriquement nos hypothèses n’est évidemment pas facile. Nous essayons plutôt d’expliquer des notions telles que l’objectivité justement en décrivant leurs fonctions dans le discours scientifique. Ensuite, nous argumentons pourquoi telle ou telle approche est plus prometteuse.
Aussi objectif que possible
Jan Sprenger est professeur de logique et de philosophie des sciences à l’Université de Turin. Spécialisé dans les questions épistémologiques, il a dirigé le projet de recherche européen «Making Scientific Inferences More Objective» jusqu’en 2021. Ce dernier visait à mieux comprendre l’objectivité des conclusions statistiques, causales et explicatives.
Comment l’objectivité fonctionne-t-elle en sciences sociales et en sciences naturelles?
Les sciences naturelles ont la tâche plus facile, car elles disposent de théories quantitatives plus nombreuses et plus fructueuses. Celles-ci leur permettent de faire des prédictions précises qu’elles peuvent à leur tour tester avec exactitude. Voici un exemple récurrent dans les manuels de physique: grâce aux déviations orbitales de la planète Uranus, la position de Neptune a pu être prédite avec succès. En cas de doute, les sciences naturelles disposent par ailleurs d’un laboratoire où elles peuvent réaliser une expérience donnée – en thermodynamique par exemple – sans influences extérieures pertinentes. Cela s’avère beaucoup plus difficile en sciences sociales, car il s’agit de systèmes complexes avec un réseau d’influences causales qui ne se laissent pas isoler si facilement.
Par exemple?
Comment le racisme apparaît-il? On ne peut guère le tester en laboratoire. De très nombreuses influences entrent en jeu. Il va de soi que les sciences sociales réalisent également des expériences en laboratoire sur des questions spécifiques, telles que: à quel point les personnes se font-elles confiance lorsqu’il s’agit d’argent? Mais la question de savoir comment ces idéalisations peuvent ensuite être transposées dans la société reste ouverte.
Concrètement, comment l’objectivité est-elle donc produite dans le travail de recherche?
C’est complexe. Toutefois, deux idées fondamentales prédominent: les uns invoquent le produit du travail de recherche. Par exemple, le résultat d’une expérience est considéré comme objectif s’il peut être reproduit indépendamment par différents chercheurs et chercheuses à divers moments et lieux. D’autres mettent l’accent sur le processus qui permet de tenir à l’écart du travail empirique les partis pris personnels. Lorsque nous parlons d’objectivité en science, sans donner davantage de précisions, nous faisons généralement référence à une objectivité où ces deux idées se recoupent. J’estime toutefois qu’il est important de faire la distinction entre l’objectivité du produit et l’objectivité du processus.
Tout cela est assez abstrait.
C’est vrai. Mais ce qui m’intéresse particulièrement dans le concept d’objectivité, c’est comment il peut être utile dans la pratique quotidienne de la recherche. Pour cela, restons-en à l’aspect du processus. Quand il est impossible d’exclure la présence de valeurs dans l’argumentation scientifique ou l’analyse de données, les chercheuses devraient les rendre transparentes. Cela peut concerner par exemple le choix des hypothèses testées ou les probabilités qu’on leur attribue. Les scientifiques peuvent aussi montrer en quoi les conclusions d’une expérience auraient été différentes s’ils avaient posé d’autres conditions.
Vu ainsi, peut-on éviter la subjectivité?
Il est impossible, par exemple, d’analyser un jeu de données sans émettre certaines hypothèses, par exemple à propos des facteurs qui influencent ou non la confiance des gens les uns envers les autres. Le jugement subjectif s’avère donc indispensable. C’est pourquoi ces éléments subjectifs font explicitement partie du raisonnement scientifique en statistique bayésienne: des probabilités subjectives sont attribuées à des hypothèses, et leur valeur peut éventuellement changer à la lumière des résultats expérimentaux. Par contre, la question de la probabilité d’une hypothèse n’entre absolument pas en ligne de compte en statistique classique. Il s’agit simplement de savoir dans quelle mesure l’hypothèse nulle – le standard qui sert de point de départ sans effectuer d’enquête – d’une absence de relation causale explique bien ou mal les données. Tout jugement subjectif est écarté comme n’appartenant pas à la science.
En quoi est-ce un problème?
L’une des conséquences de cette standardisation en matière de recherche statistique est que seuls les résultats dits significatifs finissent par être publiés, soit ceux qui correspondent à une valeur-p donnée. Or, ces indicateurs permettent uniquement d’affirmer que des données ne sont probablement pas le fruit du hasard. Si, par exemple, un médicament fait ne serait-ce qu’un peu mieux qu’un placebo dans le cadre d’une large expérience menée sur 100 000 patients, le résultat est presque certainement statistiquement significatif en raison du très grand échantillon. Mais cela ne dit rien sur la capacité réelle de ce médicament à lutter contre la maladie. C’est pourquoi, depuis quelques années, un mouvement scientifique œuvre pour que l’on ne se fie plus aux seules valeurs-p. Mais cette approche a dominé pendant des décennies et a fait beaucoup de dégâts.
L’objectivité est-elle réellement une bonne chose?
C’est grâce à elle que l’on fait confiance à la science et qu’elle est pertinente dans le discours sociétal. Si l’on prend l’objectivité du processus comme point de départ, à savoir que l’objectif premier est d’écarter le plus possible les partis pris personnels, l’idée n’est pas non plus synonyme d’attentes trop élevées. Mais si l’on entend par objectivité une conformité à la réalité, la science n’est pas toujours en mesure de la garantir. Elle est bien trop complexe pour cela.
Cette exigence serait-elle une nouvelle dimension de l’objectivité? Outre l’objectivité du processus et celle du produit?
L’objectivité en tant que conformité à la réalité est une vieille idée. Elle transparaît dans la notion d’objectivité du produit. Mais il est difficile de mesurer directement cette conformité.
En résumé, quelles sont les conditions à remplir pour une combinaison pratique entre objectivité du produit et objectivité du processus?
Cela repose sur un travail expérimental et implique un haut degré de reproductibilité et une évaluation des théories davantage guidée par des preuves que par des convictions personnelles.
Cela convient bien aux sciences naturelles et sociales. Mais qu’en est-il en sciences humaines? Une historienne peut sciemment examiner une source du point de vue d’un groupe marginal donné. Dans ce cas, le parti pris est pour ainsi dire une méthode.
Cette approche peut s’avérer tout à fait judicieuse, car on développe ainsi une perspective jusqu’alors inconnue. Il est toutefois important de la signaler. Et d’avoir suffisamment d’autres approches qui réinterprètent la source selon une perspective différente. Les sciences humaines progressent précisément grâce à la confrontation.
Dans quelle mesure?
En sciences naturelles, on accepte un paradigme en y travaillant. Dans les sciences humaines, on cherche plutôt à approfondir la compréhension d’un phénomène donné à l’aide d’approches d’interprétation contraires. Dans de tels cas, un consensus scientifique constitue un résultat objectif. Les sciences humaines ne disposent guère de théories générales, comme les lois de Newton en physique, qui puissent guider la recherche. Elles dépendent bien plus de l’étude de cas individuels concrets.