Débat: les neurosciences sont-elles utiles en psychiatrie?
Imagerie cérébrale, génétique et expériences animales font continuellement avancer notre compréhension du cerveau. Mais ce savoir est-il pertinent pour traiter des patients souffrant de troubles psychiatriques?
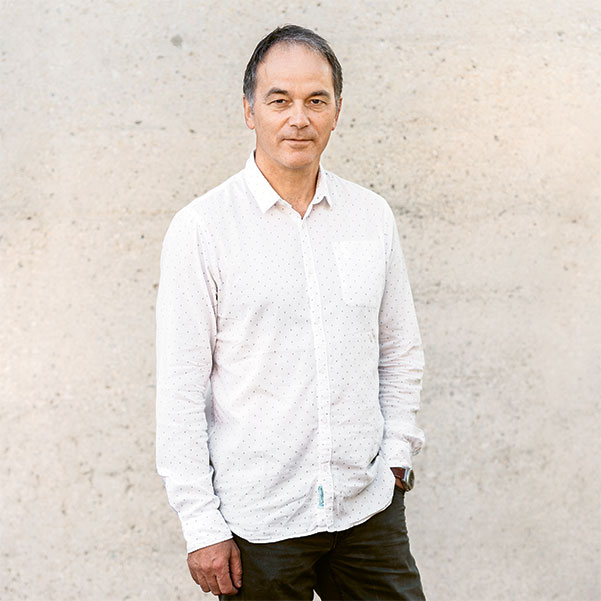
Image: Valérie Chételat
Il est indéniable que la pratique contemporaine de la psychiatrie est à des lieues de l’approche asilaire des années 1950. Le développement des neuroleptiques a permis un changement radical dans le traitement de la psychose. Les approches psychothérapiques se sont diversifiées de manière considérable et leur efficacité est maintenant scientifiquement établie. Enfin, le mouvement de désinstitutionalisation a conduit au développement de soins dans la communauté et à un changement d’attitude à l’égard des patients; ces derniers jouent désormais un rôle central dans la définition de leur traitement.
Les développements survenus au cours des quarante dernières années se limitent pourtant à l’amélioration de concepts existants. Le progrès continue de buter sur les mêmes obstacles: définitions imprécises de diagnostics réunissant sous une même bannière des patients souffrant de maladies vraisemblablement différentes, variations énormes dans la réponse à des traitements qui restent sans effet sur de nombreux aspects de la symptomatologie, taux élevé d’effets secondaires et absence d’effets sur le fonctionnement social.
Notre absence de connaissances des mécanismes neurobiologiques à l’origine des troubles psychiatriques joue un rôle central dans cette situation, et c’est là que les neurosciences doivent contribuer à améliorer les pratiques cliniques. Un tel savoir permettrait d’augmenter la validité des diagnostics et de développer des médicaments agissant sur la cause des maladies plutôt que sur leurs conséquences. Identifier des biomarqueurs renforcerait les stratégies d’intervention précoce, l’un des espoirs majeurs de progrès en psychiatrie.
Vision utopiste d’un futur inaccessible? Pas vraiment… Le Pôle de recherche national Synapsy met en synergie cliniciens et neuroscientifiques pour travailler à la résolution de ces questions. Par exemple l’étude du rôle d’une carence en antioxydants cérébraux dans la psychose s’est avérée particulièrement encourageante. Un essai randomisé chez des jeunes patients souffrant de psychose a démontré que la supplémentation en précurseur du glutathion – principal antioxydant cérébral – conduit à l’amélioration clinique dans un sous-groupe identifiable par une mesure du déséquilibre redox dans le sang. L’action biologique de traitement est confirmée par l’augmentation observée du taux de glutathion intracérébral ainsi que par la restauration de la substance blanche du cerveau.
Si les domaines de la psychiatrie dans lesquels ce type d’approche est utile sont encore rares, il est urgent d’y investir de l’énergie. Ne pas le faire serait tourner le dos à des progrès dont les patients ont grandement besoin. Il ne doit naturellement pas s’agir d’un choix aux dépens des approches actuelles, mais d’une ouverture à un nouveau regard qui permettra de les améliorer.
Professeur à l’Université de Lausanne et codirecteur du Pôle de recherche national Synapsy, Philippe Conus dirige le Service de psychiatrie générale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne.

Image: Valérie Chételat
Commençons par dire que sans cerveau il n’y a pas d’expérience psychique et, ainsi, pas de maladie psychiatrique. Mais de là à affirmer que «la maladie psychiatrique est une maladie du cerveau», de prétendre que les connaissances neurobiologiques du cerveau nous permettraient de comprendre le psychisme et de mieux traiter les troubles psychiatriques, c’est tirer une conclusion hâtive.
Le psychisme est un phénomène émergent et, bien qu’issu des processus neurobiologiques, irréductible à ceux-ci. Les propriétés du psychisme et surtout ce qu’on appelle dans le sens plus large la conscience n’existent pas préalablement dans les éléments qui composent le cerveau, mais résultent de leur interaction. Et la complexité de ces interactions dépasse encore aujourd’hui clairement les moyens de recherche disponibles.
Chercher les causes des maladies psychiatriques dans la biologie, c’est prendre ce qu’on appelle une posture essentialiste. Pour cette dernière, un diagnostic sert à étiqueter une maladie en la considérant comme une chose naturelle, qui existait a priori avant même que l’on ne se pose la question de son existence, et qu’il s’agirait ainsi de découvrir. En revanche, pour le nominaliste que je suis, une maladie est à définir uniquement en fonction de son éventuelle utilité; elle n’est donc pas à «découvrir» mais à construire. Le diagnostic est alors une affaire politique: le résultat d’un consensus social qui peut à tout moment changer en fonction des contextes et des intérêts en jeu.
Confondre maladie du cerveau avec maladie psychiatrique revient à commettre une erreur dite de catégorie: on présente des choses faisant partie d’une catégorie particulière (ici, le cerveau qui relève de la biologie) comme si elles appartenaient à une catégorie différente (la psychologie). Or, il s’agit de deux domaines complètement distincts et irréductibles l’un à l’autre. Ce serait le même type d’erreur que de prétendre qu’il est possible de révéler le génie artistique d’un Picasso en nous basant sur la structure chimique de la toile et des couleurs d’un de ses tableaux. Il est non seulement fallacieux de dire que les synapses pensent, mais également que le cerveau pense. La neuroimagerie ne nous laisse pas voir des pensées, des motivations ou des émotions, mais peut montrer des corrélats d’événements neurobiologiques qui eux – dans le cas idéal – sont corrélés aux phénomènes psychiques.
Il ne s’agit ici aucunement d’un plaidoyer contre la méthode scientifique, basée sur la formulation d’hypothèses et sur leur falsification. Il est en revanche crucial de formuler celles-ci correctement. De la même manière qu’il ne faut confondre hypothèses géologiques et sociologiques, il faut pas confondre hypothèses biologiques et psychologiques.
Daniele Zullino est professeur au Département de psychiatrie de l’Université de Genève et chef du Service d’addictologie aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).




