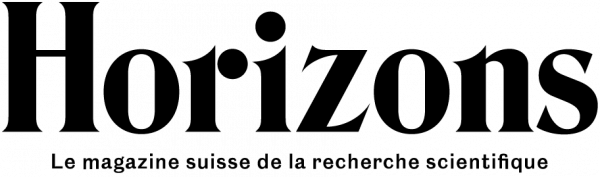Dossier: Voir pour savoir
Des portails qui ouvrent sur l’univers des nains et des géants
Des procédés d’imagerie permettent aux scientifiques de rendre visible ce que l’œil humain ne peut percevoir. Sept techniques décisives et ce qu’elles peuvent montrer.

Photo: Keystone / Science Photo Library / Steve Gschmeissner
Les électrons confèrent une impressionnante profondeur de champ au microcosme
Il y a plus de 350 ans, des dessins faits à l’aide de simples microscopes optiques montraient déjà des insectes agrandis. Comme la célèbre puce du naturaliste britannique Robert Hooke dans son ouvrage «Micrographia». Les détails du corps de ces petites vermines ont permis de découvrir des dimensions jusqu'alors inconnues. Ces mêmes instruments ont également permis d'observer pour la première fois des cellules et des bactéries.
Mais des contraintes physiques limitent la résolution des images obtenues avec la lumière visible. En utilisant des électrons à la place des photons, la microscopie permet de rendre des détails jusqu’à 100 fois plus fins. «C’est une étape très difficile, explique Jacques Dubochet, ancien spécialiste en biophysique à l’Université de Lausanne. Car dans le microscope électronique, il y a un vide et il est sec – c’est malheureux pour la biologie!» C’est pourquoi il a continué à perfectionner la technique et a ainsi réussi à refroidir les échantillons à près de -200 °C, si rapidement que l’eau se solidifie sans former de cristaux de glace. C’est cette méthode de cryomicroscopie électronique qui lui a valu d’être récompensé par un prix Nobel en 2017.
La fourmi représentée ci-dessus n’atteint pas encore de telles limites. Pour analyser de telles surfaces, l’échantillon est recouvert d’un métal comme l’or. Ensuite, il est parcouru point par point par le faisceau d’électrons d’un microscope électronique à balayage. Ainsi peuvent être générées des images avec une très grande profondeur de champ. «Cela agrandit également le monde que nous construisons dans notre esprit», remarque Jacques Dubochet.

Photo: Event Horizon Telescope
Un trou noir dont on ne voit que l’ombre
Pendant une nuit d’avril 2017, huit radiotélescopes répartis autour du globe et synchronisés à l’aide d’horloges atomiques ont observé un point dans le ciel: le trou noir supermassif situé au centre de la galaxie M87, dans la constellation de la Vierge. A cette fin, les télescopes ont été synchronisés avec des horloges atomiques. Les quantités de données collectées étaient si importantes qu'elles n'ont pas été envoyées par Internet, mais par avion sur des disques durs spécialement conçus à cet effet. C'est à partir de ces données que les chercheurs ont calculé l'image ci-dessus, qui a fait le tour du monde deux ans plus tard.
Ce n’est pas le trou noir lui-même qui est visible, mais le gaz en rotation autour de lui qui brille fortement à cause de sa grande vitesse, environ un quart de celle de la lumière. La tache noire à l’intérieur de l’anneau lumineux n’est pas le trou noir (un point invisible infiniment petit) mais son ombre. Celle-ci provient de la lumière qui ne peut s’échapper du trou noir ou qui est déviée hors du champ du télescope. «Ce phénomène avait été prédit par la théorie de la relativité d’Einstein, mais n’avait encore jamais été observé auparavant», a écrit Heino Falcke de l’Université Radboud (NL) dans le communiqué de presse du projet. Au fait: le diamètre de l’anneau lumineux est 25 000 fois plus grand que la distance entre la Terre et le Soleil.

Photo: Copernicus Sentinel data (2015) / Esa
Surveillance complète de la photosynthèse vue du ciel
Le satellite Sentinel-2A survole chaque endroit de la Terre tous les cinq jours à midi pile, heure locale, et photographie le globe depuis 2015 avec 13 canaux et une résolution d’image allant jusqu’à 10 mètres. «Les données étaient très précieuses peu après son lancement, puis moins. Et maintenant, après dix ans, les comparaisons à long terme avec toujours le même capteur sont à nouveau très appréciées», explique Robert Meisner, l’un des responsables du service de communication de l’ESA.
L’image ci-dessus montre la ville de Berlin en juillet 2015. Le contraste entre le parc urbain boisé du Tiergarten au centre et la ville environnante ressort particulièrement. Les forêts de Grunewald et Königswald, au sud-ouest, sont aussi bien visibles. «Sur l’image satellite, nous avons remplacé le canal rouge par l’infrarouge. Dans ce domaine spectral, la végétation réfléchit beaucoup mieux», explique Robert Meisner. C’est pourquoi les plantes n’apparaissent pas en vert comme d’habitude. Agriculteurs, analystes boursiers et chercheuses en climatologie utilisent ces images en fausses couleurs pour surveiller l’état de la végétation. Le principe final: plus il y a de rouge, plus il y a de plantes et plus elles sont actives dans la photosynthèse.

Photo: Kevin Mackenzie / University of Aberdeen / Science Photo Library
Cellules en clair-obscur
Un laser balaye la cellule point par point. Lorsqu’il rencontre une molécule fluorescente, celle-ci s’illumine. Un système optique complexe garantit que seule la lumière provenant de cette position précise est enregistrée. Peu à peu, le dispositif produit une image de la cellule entière ou, plus exactement, de toutes les molécules fluorescentes qu’elle contient. Le reste demeure obscur.
«La microscopie confocale à fluorescence permet de découper une tranche optique de l’échantillon», explique Kevin Mackenzie, ancien directeur du service de microscopie de l’Université d’Aberdeen. Il a utilisé dans cette image différents colorants fluorescents pour les composants de la cellule: le noyau en bleu, le cytosquelette en vert, les mitochondries en rouge. L’utilisation d’anticorps ou de techniques génétiques permet d’être plus précis encore et de déterminer par exemple si des structures se touchent. Des coupes individuelles peuvent aussi être superposées pour former des images en 3D. Cela peut se faire pendant que les cellules sont encore vivantes et que les structures sont même éventuellement encore en mouvement.
Cette image de cellules de l’artère pulmonaire permet par exemple d’étudier le comportement des mitochondries dans des conditions pauvres en oxygène ou leur rôle dans le développement de cancers. Durant sa carrière, Kevin Mackenzie a déjà examiné des larves d’abeilles sur des piqûres d’acariens, observé des cellules osseuses avec des lunettes 3D et étudié la formation de filaments fongiques dans des cellules de levure. «J’ai toujours aimé regarder de nouvelles choses», confie-t-il.

Photo: Victor Shahin, Hans Oberleithner, University Hospital of Muenster / Science Photo Library
Topographie à précision atomique
Le développement du microscope à effet tunnel a valu à Gerd Binnig et Heinrich Rohrer d’IBM Research le prix Nobel de physique en 1986. L’image ci-dessus a été réalisée à l’aide d’un appareil apparenté plus sophistiqué, le microscope à force atomique. Une aiguille métallique microscopique balaye une surface, ses mouvements étant enregistrés avec une précision atomique. Elle peut aussi appliquer une traction sur des molécules et mesurer ainsi les forces qui les retiennent. Ce faisant, nous «regardons au cœur même de la biologie», déclarait Gerd Binnig en 2016. L’image montre des pores à la surface du noyau d’une cellule. D’un diamètre d’un 10 millième de millimètre, ils contrôlent les signaux qui arrivent au génome et ceux qui peuvent sortir. Plus la structure est blanche, plus elle est haute.

Photo: Keystone / Science Source
Le chaud et le froid mènent à ce que l’on recherche
«Une photographie ne montre pas le monde tel qu’il est physiquement, explique Sabine Süsstrunk, spécialiste de la représentation visuelle et professeure à l’EPFL. Si c’était le cas, nous ne considérerions pas l’image comme une photo.» La technique reproduit donc le monde tel que nous le percevons. Tout s’accélère depuis le développement du premier capteur numérique par les laboratoires Bell en 1970: les appareils photo miniaturisés bon marché sont omniprésents, des objectifs macro aux téléobjectifs, en passant par les time-lapses, les boucles vidéo, les webcams ou encore les pièges photographiques. «Il n’existe probablement aucune discipline scientifique qui n’a pas besoin de la photographie», souligne la spécialiste.
Les caméras thermiques utilisent l’infrarouge moyen pour mesurer la température. La thermographie sert par exemple à analyser le développement de la chaleur dans les appareils, comme le moteur de voiture sur la photo ci-dessus. Et elle peut également aider à tracer les pertes thermiques des bâtiments. Elle permet même de détecter des cancers. «Nous disposons ainsi d'un instrument de mesure bidimensionnel qui nous présente les résultats de manière joliment visuelle, au lieu de nous présenter que des chiffres bruts», note Sabine Süsstrunk.

Photo: Keystone / Photo Library / Zephyr
Observer le cerveau qui pense
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est surtout connue pour les examens de l’articulation du genou. Un puissant champ magnétique aligne les noyaux des atomes d’hydrogène présents dans le corps. Des ondes radio les font ensuite vibrer pour mesurer leur emplacement. Une telle image du genou peut par exemple mettre en évidence une blessure, alors que des agents de contraste peuvent également rendre visibles des éléments tels que des tumeurs.
L’hémoglobine présente dans le sang constitue un agent de contraste naturel qui peut révéler quelles régions cérébrales sont les plus irriguées en oxygène, comme on peut le voir sur l'image ci-dessus. «Dans nos études, nous observons des personnes pendant qu’elles réfléchissent», résume dans une vidéo Lydia Hellrung, postdoc à l’Université de Zurich. Avec ses collègues du Centre de neuro-économie, elle utilise cette méthode pour examiner comment les gens tentent de modifier leur comportement.